Onomastique et humour : Mes notes de lecture de Moby Dick.
Il aimait à épousetter ses vieilles grammaires ; d'une certaine manière, cela lui rappelait qu'il était mortel. Herman Melville, Moby Dick.
Sur quel océan me suis-je embarqué ? Le fond de cet article ne pourrait jamais être sondé, fût-ce avec une ligne de 18 fils de 120 brasses. J'abandonne toute idée d'exhaustivité ; ce ne sera qu'une esquisse, que dis-je, même pas : l'esquisse d'une esquisse ; que Dieu me garde de jamais rien parfaire. Je publie en l'état.
I. ONOMASTIQUE.
S'il est un livre qui s'attache avec humour à l'origine des noms, comment cela ne serait-il pas Moby Dick ? Melville n'a-t-il pas dressé Humour et Étymologie comme deux marraines qui président au lancement de l'ouvrage, deux fières cariatides soutenant l'édifice, lui qui débute par son Étymologie (fournie par un pion de collège qui mourut tuberculeux) et la fait suivre par un petit prologue de ses Extraits, autoportrait en bibliothécaire parcourant l'océan des rayonnages, naviguant sans fin sur la mer Vaticane qui est un des grands bonheurs de la littérature comique? [si réussi, si hilarant que je résiste difficilement à me payer le plaisir de le recopier ici].
Comment Melville choisissait-il les noms de ses personnages et de ses navires ? Glissait-il au hasard la lame acérée de son vistemboir sur la tranche dorée de sa Bible et de ses Encyclopédies pour y trouver, désigné par le doigt de Dieu, le nom de baptême de ses héros ? Pour trouver la réponse à cette question, il suffit d'inscrire sur son moteur de recherche "Onomastique" et Moby-Dick". Las, aucune réponse réelle sur les 1870 propositions (seulement). Allons, il suffit de consulter la riche bibliographie de l'édition Pléiade de Melville ! Aucun ouvrage, aucun article ne s'y consacre. L'onomastique de Moby-Dick, avec ces centaines de noms d'auteur, serait-il un serpent-de-mer qu' aucun universitaire n'oserait se vanter d'avoir capturé ? Impossible. Je suis, seulement, un piètre explorateur des immensités textuelles, et, dans quelque réserve, les mémoires consacrés à ce sujet mythique attendent, jalousement gardés par un directeur de thèse attendant sa grande heure, une triomphale publication sous son nom.
Ou encore, la Bête onomastique trop pourchassée aurait-elle sondé ?
Croulant sous son propre poids, le Sujet en or aurait-il été détruit par quelque Moïse par ordre d'un Éditeur jaloux ?
Ce vase séphirotique trop riche des 777 noms propres de l'Œuvre se serait-il brisé en d'innombrables étincelles qui, désormais mêlées à des scories qélipothiques et éparpillées dans les foot-notes de milliards d'ouvrages, ne pourraient plus être rassemblées ?
Qu'adviendra-t-il de ce misérable blog s'il se lance à la quête de ce Graal ? Est-ce ici le Lieu secrètement désigné depuis cent cinquante ans pour en voir, sonnez haut-bois, résonnez musettes, le joyeux avènement en l'humble étable dont je serai l'âne? Ah, avec quel enthousiasme alors viendrais-je alors réchauffer de mon museau le petit être et lui faire les marionnettes avec mes oreilles !
Je m'embarque vers ces espaces infinis :
0) préliminaire : les Extraits.
Après avoir placé ses cariatides, Melville nous fait parcourir un long couloir (p.5-20)* où sont suspendus les portraits des Auteurs Illustres ; où, si l'on veut, il nous fait visiter les in-folio et volumes empoussiérés de sa bibliothèque, histoire de dire que Moby Dick, placé sous leur patronage, en est nourri. A bon entendeur, à bon harponneur de clef pour une onomastique, salut !
* mes références renverront à la dernière édition française de Moby-Dick, traduction de Philippe Jaworski, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 2006.
Or, cette théorie d'écrivain est ordonnée en une architecture savante :
- d'abord, la Bible ( la Genèse, puis Job précédant Jonas, puis Isaïe et les Psaumes),
- puis les auteurs latins (Plutarque, incontournable pour nos aïeux, Pline, même commentaire, puis Lucien, l'auteur satirique dénonçant les impostures religieuses ).
- Vient alors une citation de Le Périple d'Other ou Other, récit recueilli par le roi Alfred le Grand, AD 890. Il a été publié en latin par André Bussæus sous le titre Periplus Otheri et Wulfstani ab Alfredo, rege Angliae descriptus, Copenhague, 1744, in-8°. C'est, telle une saga, le récit de voyage de Other, norvégien de Halogaland (Nordland) qui avait visité la Mer Blanche. Cet auteur est cité par Bory de Saint-Vincent dans son Dictionnaire Classique d'Histoire Naturelle vol.3 p. 416.
- Puis deux auteurs français, et non des moindres, Montaigne et Rabelais : c'est dire si le crible critique, le scepticisme et le renversement carnavalesque des valeurs vont être au rendez-vous. C'est l'Apologie de Raymond Sebond de Montaigne qui est citée ; et on sait qu'alors que Sebond confiait à l'homme une place centrale et sommitale au sein de la création, la dignité de l'homme se justifiant par le fait que l'homme occupe le sommet de la hiérarchie des êtres, que Dieu l'a façonné à son image de telle sorte qu'il soit capable, par l'exercice de la raison, de s'élever jusqu'au divin, Montaigne démontre bien l'inverse, critiquant le rationalisme et écrivant : " Est-il possible de rien imaginer si ridicule que cette misérable et chétive créature, qui n'est pas seulement maîtresse de soi, exposée aux offenses de toute chose, se dise maîtresse et emperière de l'univers, duquel il n'est pas en sa puissance de connaître la moindre partie, tant s'en faut de la commander." Allez chasser la baleine avec une telle philosophie à bord ! La citation que donne Melville est très peu explicite, et il semble avoir volontairement donné de chaque auteur des citations si brèves et si dénuées de sens quoique contenant le mot whale que cela ressemble, soit à une parodie insensée d'un catalogue médiéval (où la simple citation d'un ancien "autorise", valide le texte), soit aux citations d'un dictionnaires, simples exemples de l'usage d'un terme ne se préoccupant pas de leur sens. Ici, il donne l'extrait où Montaigne parle du Gayet de mer, poisson pilote qui accompagne les cétacés (mais aussi les squales) pour le guider sans se faire manger. Si on se rapporte à la source Livre II chapitre XII, on découvre qu'il s'agit d'une démonstration des qualités des sociétés animales, égales ou supérieures aux sociétés humaines comme en témoigne les manchettes: Le chien plus fidèle que l'homme...Noble gratitude d'un Lion...Société qui s'observe entre les animaux...entre la baleine et un petit poisson. A noter que ces exemples sont repris de Plutarque.
-
Enfin, et enfin seulement, presque 70 citations d'auteurs plus ou moins anglais (où surnage le français Cuvier [Le régne animal Vol. 1 p. 174]: "Les cétacés sont les mammifères sans pieds de derrière"). Là encore, elles sont si brèves que le sérieux de leur référencement bibliographique est détruit par la corrosion de l'absurdité de leur succession ; certaines affirment savamment que l'on ne sait rien des cétacés ("Le savant Hosmannus dans son œuvre de trente années dit clairement : Nescio quid sit."). De ce salmigondis où se mêlent en une danse sarcastique Darwin, Hawthorne, Goethe, les chants de Baleiniers, Fenimore Cooper, les récits de mer, des coupures de journaux et fragments de dictionnaires, il ne ressort rien d'autre que l'image dérisoire des prétentions humaines au Savoir.
1. Le Titre : Moby-Dick.
Il aurait fallu commencer par lui ; mais on trouve partout les explications nécessaires. Je rappelle que :
a) Le premier titre prévu était The Whale, Le Cachalot. Cela explique que les étymologies et les citations des Extraits viennent illustrer le mot whale.
b) Au dernier moment de l'édition, en septembre 1851 (le livre sera publié à Londres le 18 octobre), Melville change ce titre pour Moby-Dick.
c) L'édition anglaise est publiée sous le titre The Whale et, en sous-titre, or, Moby-Dick.
d) L'édition américaine sortira le 14 novembre 1851 sous le titre Moby-Dick ; or, The Whale.
e) Le nom de Moby-Dick ne réapparaît, après sa mention dans le titre qu'à la page 189 (de l'édition française) au chapitre 36, prononcé par Tashtego, et repris par Achab: — Moby Dick ? hurla Achab. Tu connais donc le cachalot blanc, Tash ? . Moby Dick est le nom de titre du chapitre 41.
Influence du nom Mocha Dick.
On estime que Melville s'est inspiré du récit de Jeremiah N. Reynolds, "Mocha Dick ou le Cachalot blanc du Pacifique", publié dans le magazine populaire new-yorkais The Knickerbocker en mai 1839 très peu de temps avant l'embarquement de Melville, à vingt ans, sur un navire marchand vers Liverpool.
Le titre original est Mocha Dick, or The White Whale of the Pacific: A Leaf from a ManuscriptJournal, The Knickerbocker XII, 1839, pp. 377-392.
C'est le récit, par le second d'un baleinier de New York, de sa capture d'un cachalot , "blanc comme la laine", un vieux mâle solitaire, monstre célèbre parmi les marins pour être sorti victorieux de cent combats, et pour sa taille et sa force exceptionnelle. Ce redoutable animal surnommé aussi The Stout Gentleman, "le gros monsieur", était à cette époque si réputé que sa prise avait valu à l'officier la réputation la meilleure parmi les harponneurs de Nantucket Outre sa couleur, il se distinguait par son souffle qui, au lieu de se diriger vers l'avant selon une ligne oblique, accompagné de brefs hoquets, s'élevait par son nez en une haute fontaine verticale d'un vaste volume, à intervalles réguliers assez espacés les uns des autres, dans un grondement continu, "comme la soupape de sécurité d'une puissante machine à vapeur". Les balanes ou bernaches, qui salissent si facilement les carènes des navires mais se fixent rarement sur les cachalots, étaient si développées sur sa tête (il s'agit de whale barnacle, plus simplement corolunidae) qu'elles étaient agglomérées pour la couvrir entièrement. Il aurait été vu pour la première fois avant 1810 près de l'île de Mocha qui donna son nom au vieux Dick.
Cette île montagneuse des côtes chiliennes, de 49 km de long, est située à 38° 22′ Sud et 73° 54′ Ouest au large de la province Arauco. Selon Isidore Duperrey, qui y fit escale à bord de la corvette La Coquille, l'île avait été le point d'atterrissage favori des premiers navigateurs pénétrant dans les mers du sud et soucieux d'échapper aux tracasseries des espagnols : Francis Drake en 1578, Olivier Van Noord en 1600, l'amiral Spilbergen en 1615 et bien d'autres, y étaient accueillis par des Indiens de souche, qui voulaient bien leur offrir moutons, volailles ou fruits et les ennivrer de Chicha, mais leur refusaient, rigoureusement, l'entrée de leurs demeures et de leurs femmes. Le mouillage fréquentè par les baleiniers se trouvait, et se trouve peut-être encore, sur la côte nord. Ils y faisaient aiguade d'une eau pure, s'avitaillaient de cochons sauvages dont ils vantaient la délicatesse de la chair, des légumes et des fruits mais "l'imprévoyance de leur caractère prodigue et insouciant de l'avenir" fut telle que Duperrey trouva l'île déserte. Le souci onomastique exigerait de découvrir l'origine du toponyme Mocha, terme à l'évidence espagnol, mais cela supposerait quelque connaissance linguistique plus sérieuse que celle que procure la consultation du dictionnaire : Mocha adj.f. "émoussée", "étêtée". S'applique mal à un cachalot dont la tête, qui pèse seize tonnes, représente le tiers du cétacé.
Je rappelle que si la plupart des cétacés portent sur la tête un melon, organe de tissu gras servant de régulateur de flottabilité, les cachalots s'enorgueillisent de porter en guise de coiffure/burette d'huile un spermaceti, qui détrône définitivement tous les bearskin , les bobs, bonnets, bibis, bérêts, bollenhuts, zé autres borsalinos.
 (Wikipédia Cachalot)
(Wikipédia Cachalot)
Comme les loups blancs et les merles blancs, les cachalots blancs ne sont pas des unicum, et si cet exemplaire d'in-folio portait un nom propre et se faisait reconnaître, c'est que, outre sa reliure en velin immaculé, il portait quelque ex-libris laissé par des humains qui avaient eu l'imprudence, ou l'audace, d'aller le consulter : en l'occurence, il s'agissait des fers de harpons qui hérissaient son dos, accompagnés, selon Reynolds, de 50 à 100 yards de ligne. Cent yards (ou verges) de trois bons pieds anglais, cela représente tout-de-même une traîne de 91,4 mètres, quoiqu'on puisse supposer que les mensurations données par Reynolds soient cumulatives des quantités de cordages qui, tels les paperoles de Proust, attachaient les Forget-me-not de chaque harponneur, par autant de fers, au corps tant recherché.
— Dick, diminutif de Richard, renvoie à l'habitude des baleiniers d'attribuer des prénoms aux cachalots les plus combattifs ; dans le texte de Reynolds, Mocha Dick est nommé simplement Dick. Les cachalots sont aussi désignés sous le terme de "old bull" ou "old sog".
— Mocha : "originaire de l'île Mocha".
Influence de Bobby, Johny, etc...
Si on oublie que , selon une note énigmatique n°27 de la page 166 de The Trying-out of Moby-Dick (1949) de Howard P. Vincent , "un auteur", qu'il ne cite pas, prétend que ce Mocha Dick était aussi nommé Moby Dick, si on se débarasse comme d'un scrupule (scrupulum, "petit caillou" de cette footnote, on peut penser que Melville est le créateur de ce nom de Moby Dick, récupérant le nom Mocha Dick pour le rendre plus conforme à ses intuitions créatrices. Il a donc modifié Mocha en Moby , et donc -cha en -by, ce qui, à mes oreilles, sonne comme un diminutif affectueux de prénom rappelant Johny, issu de John, Bobby issu de Bob, ou Roby issu de Robert. Bref, Melville forgea, à partir de Mocha, une forme hypochorique rejoignant les Jacky et les Jakey, les Juddy et les Jerry, les Amy, les Nancy, les Barbie, les Davy et les Danny, les Gerry et les Franckie, les Sally, les Mary, les Molly et les Teddy, les Jimmy et les Betty, les Maggy et les Peggy, Stevie, Susy, Bobby, Billy, Wally, Willy, et les Micky, et les Kimmy, pour finir avec les Laury.
Influence du Livre de Job et du Livre de Tobie.
Mais le mot m'évoque aussi la sonorité de Job, un nom qui hante tout le roman, et celui de Toby. Je me plais donc à penser que l'imaginaire de Melville a procédé à la fusion de Mocha, Job et Toby pour produire Moby. Il a conservé, pour honorer quelque vieux Richard, (the old Rick, Ritchie, Ritchie-Dickie) le Dick final qui claque comme un coup de fouet frappé par la queue du cachalot.
L'influence du nom Toby est bien probable. Toby est un prénom répandu dans le monde anglo-saxon. En France, il évoque d'abord le prénom biblique Tobie et le Livre de Tobie, (de l'hébreu Tobi, "mon bien" et Tobiah, "Dieu est mon bien") mais on doit se remémorer que le chapitre 6 de ce Livre mentionne "un énorme poisson" très comparable à celui, beaucoup plus connu, de Jonas :
"Tobie partit, suivi du chien, et il fit sa première halte près du fleuve du Tigre. Comme il descendait sur la rive pour se laver les pieds, voici qu'un énorme poisson s'élança pour le dévorer. Effrayé, Tobie poussa un grand cri, en disant: " Seigneur, il se jette sur moi! " L'ange lui dit: " Prends-le par les ouïes et tire-le à toi. " Ce qu'ayant fait, il le tira sur la terre sèche, et le poisson se débattit à ses pieds. L'ange lui dit: " Vide ce poisson, et conserves-en le coeur, le fiel et le foie, car ils sont employés comme d'utiles remèdes. " Il obéit; puis il fit rôtir une partie de la chair, qu'ils emportèrent avec eux pour la route; ils salèrent le reste, qui devait leur suffire jusqu'à ce qu'ils arrivassent à Ragès, ville des Mèdes. Et Tobie interrogea l'ange, en disant: " Je te prie, Azarias mon frère, de me dire quelle vertu curative possèdent les parties de ce poisson que tu m'as commandé de garder. " L'ange lui répondit: " Si tu poses sur des charbons une petite partie du coeur, la fumée qui s'en exhale chasse toute espèce de démons, soit d'un homme, soit d'une femme, en sorte qu'ils ne peuvent plus s'en approcher. Et le fiel sert à oindre les yeux couverts d'une taie, et il les guérit. " Par ces remèdes, Tobie guérira Sarah, sa future épouse, de ses démons, puis il libérera son père Tobit de son aveuglement.
Le Livre de Tobie, livre deutéronomique ou apocryphe, ne nous est parvenu que par sa traduction dans la Septante, quoiqu'il ait été écrit en langue sémite (hébreu ou araméen) vers le 3-2e siècle avant J.C. Le mot "poisson" traduit le grec ἰχθὺς, traduit en latin par piscus. Ces mots sont les mêmes qui désignent dans le Livre de Jonas, le grand poisson que nous considérons comme une baleine, et rien ne s'oppose, à part la mention des ouïes, à ce que nous considérions, si tel est notre bon plaisir, cet "énorme poisson qui s'élance pour dévorer" Tobie comme une baleine...ou un cachalot.
Il existe un autre motif pour que le nom de Tobie ait "contaminé" celui de Moby, motif bien connu par tous les lecteurs de Melville, c'est que ce dernier a surnommé Toby son compagnon Richard Tobbias Greene dans le récit qu'il donne dans Typee (Taïpi) de sa désertion du baleinier Acushnet et de ses aventures aux Îles Marquises.
Nommer les animaux pourchassés : une tradition.
On ne s'étonnera pas que le cachalot blanc qui fréquentait les côtes de l'Arauco et l'île Mocha ait reçu un nom propre : Melville lui-même nous signale (Chapitre 45, p. 233-234) qu'un certain nombre de proies, particulièrement remarquables, recevaient des marins l'hommage d'un surnom. il nous donne les exemples suivants qui permettent l'étude onomastique d'une courte série :
- Timor Tom . Trad : Jack de Timor (P.J), Tom Timor (H. G-R)
- New Zealand Jack . Trad : Tom de Nouvelle-Zélande (P.J), Jack de Nouvelle-Zélande (H. G-R)
- Morquan (O, Morgan ! King of Japan)
- Don Miquel (O, Don Miquel, thou Chilian whale)
Je me permets de citer tout le passage, car c'est, dans une écriture flamboyante, un ode de l'onomastique :
But not only did each of these famous whales enjoy great individual celebrity—nay, you may call it an oceanwide renown; not only was he famous in life and now is immortal in forecastle stories after death, but he was admitted into all the rights, privileges, and distinctions of a name; had as much a name indeed as Cambyses or Caesar. Was it not so, O Timor Tom! thou famed leviathan, scarred like an iceberg, who so long did’st lurk in the Oriental straits of that name, whose spout was oft seen from the palmy beach of Ombay? Was it not so, O New Zealand Jack! thou terror of all cruisers that crossed their wakes in the vicinity of the Tattoo Land? Was it not so, O Morquan! King of Japan, whose lofty jet they say at times assumed the semblance of a snow-white cross against the sky? Was it not so, O Don Miguel! thou Chilian whale, marked like an old tortoise with mystic hieroglyphics upon the back! In plain prose, here are four whales as well known to the students of Cetacean History as Marius or Sylla to the classic scholar.
But this is not all. New Zealand Tom and Don Miguel, after at various times creating great havoc among the boats of different vessels, were finally gone in quest of, systematically hunted out, chased and killed by valiant whaling captains, who heaved up their anchors with that express object as much in view, as in setting out through the Narragansett Woods, Captain Butler of old had it in his mind to capture that notorious murderous savage Annawon, the headmost warrior of the Indian King Philip. (Source Wikisource)
On constatera néanmoins une incongruïté : Le cachalot nommé New Zeland Jack dans sa première émergence réémerge la seconde fois du texte sous le nom de New Zealand Tom ; ce qui a incité Jaworski à inverser les deux premiers noms et à placer Tom en Nouvelle Zélande et Jack à Timor, conformément (Jaworski note 3 p. 1224) à la citation de ces zoonymes sous les plumes de Thomas Beale dans The Natural History of the Sperm Whale, p. 183, et de Frederick B. Bennet dans Narrative of a Whaling Voyage round the Globe, vol.II, p. 220. Ce dernier auteur signale que Tom de Nouvelle-Zélande se reconnaît à sa bosse blanche.
1'. Le baptême secret.
Le livre a été baptisé secrètement par Melville comme il l'écrit à Hawthorne le 29 juin 1851. (Le livre en cours d'être terminé se nomme encore The Whale) : "Voici la devise secrète du livre : "Ego non baptizo te in nomine —mais je vous laisse achever le reste". Ce "reste" est effectivement peu prononçable car diabolique et imprécatoire, c'est celui que, dans l'œuvre, le capitaine Achab prononce, ou plutôt hurle, dans le passage suivant :
" «Non, non...ce n'est pas de l'eau qu'il faut ici. Je veux la vraie trempe de la mort. Ohé, vous là-bas ! Tashtego, Quiqueg, Daggou ! Qu'en dîtes-vous, païens ? Me donnerez-vous tout le sang qu'il faut pour y plonger ce dard ?» demanda-t-il en brandissant haut le fer. Trois sombres hochements de tête lui répondirent en chœur :« Oui. » Trois incisions furent faites dans les chairs païennes, et les barbelures du cachalot blanc furent trempées. «Ego non baptizo te in nomine patris, sed in nomine diaboli !» hurlait Achab frénétiquement, tandis que le fer incandescent étanchait sa soif maligne dans le sang baptismal."
"Je ne te baptise pas au nom du père, mais au nom du diable !" Quelle violence ! Voilà la devise secrète du livre, son baptême noir, dont tous les points, le refus du Père, l'allégeance au diable, le caractère secret, le baptême par le sang, font frémir lorsqu'on pense que Melville, loin de prendre ses distances avec Achab, s'identifie à lui. Ce ne sera que trois mois plus tard que le nouveau nom de Moby-Dick sera trouvé ; et, quoique n'ayant aucun élément onomastique pour celui-ci que la proximité avec Mocha Dick, je ne serai pas surpris qu'une référence satanique y soit dissimulée.
Il semble que Melville soit passé (progressivement ou après le choc d'une rencontre avec Hawthorne) du projet d'écrire un roman documentaire humoristique sur le monde pittoresque des la chasse aux cétacés à celui de composer une tragédie shakespearienne proche du Roi Lear (Julian Markels King Lear and Moby-Dick) et qu'il en conserve, comme après un sacrifice, le sang sur les mains. Lorsqu'on lit dans sa correspondance après la parution "Je me demande si c'est mon art maléfique qui a suscité ce monstre" (p.1153), ou "J'ai écrit un livre malfaisant et je me sens [après les louanges de Hawthorne] innocent comme un agneau" (p. 1154), on suspecte l'auteur d'avoir été aussi loin que possible dans la mise à mort de son Cachalot et dans la recherche folle d'un Salut par l'échec afin d'atteindre l'apogée suprême du destin de Prométhée dans un autodafé satanique.
Si nous lisons plus en détail la lettre adressée à Hawthorne le 29 juin 1851, nous constatons que son Livre, qu'il nomme son Cachalot, dépecé, brûle dans les feux de l'Enfer et qu'il propose à Hawthorne de partager le festin (je souligne):
"Le Cachalot n'a passé qu'à moitié sous la presse ; car, las du long délai des imprimeurs et dégoûté de la chaleur et de la poussière du four à briques babylonien de New York, je suis retourné à la campagne pour sentir l'herbe et terminé le livre couché sur elle, si je le puis [...] Vous enverrai-je une nageoire du Cachalot pour y goûter ? La queue n'est pas encore cuite, bien que le feu d'enfer où flambe tout le livre ait déjà pu, raisonnablement, faire son œuvre. Voilà le devise (secrète) du livre", etc...
"Faire son œuvre", n'est-ce pas faire "l'œuvre au noir" dans quelque athanor, réussir la séparation et la dissolution qui mènera vers le Magnus Opus de la transmutation du livre en Œuvre, en Chef d'œuvre ?
2) noms bibliques.
Au chapitre XVI, Melville nous signale que la coutume d'attribuer aux habitants des noms tirés des Écritures est très répandue sur l'île de Nantucket, île des Quakers. Est-ce vrai *? Est-ce un procédé justifiant ses choix onomastiques ?
* les patronymes anciens rencontrés sont Coffin, Starbuck, Folger, Gardner, Bulker, Hussey, Coleman, Macy, Pipe...
2a. Achab.
C'est l'un de ces nom de rois de Juda que j'ai régulièrement rencontré sur les arbres de Jessé ; pourtant, ce n'est pas un roi de Juda, mais l'un des rois d'Israël, roi impie, prenant comme épouse Jezabel (qui tue les prophètes de Dieu) et adorant Baal et Astarté. Le prophète Élie tenta en vain de corriger la conduite.
Achab, sur le conseil de Jezabel, s'empare de la vigne de Naboth en faisant lapider ce dernier. Élie prophétise sa mort :
"Tu lui diras : Ainsi parle l’Éternel : N’es-tu pas un assassin et un voleur ? Et tu lui diras : Ainsi parle l’Éternel : Au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang.Achab dit à Élie : M’as-tu trouvé, mon ennemi ? Et il répondit : Je t’ai trouvé, parce que tu t’es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l’Éternel.Voici, je vais faire venir le malheur sur toi ; je te balaierai, j’exterminerai quiconque appartient à Achab, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël, et je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nebath, et à la maison de Baescha, fils d’Achija, parce que tu m’as irrité et que tu as fait pécher Israël. L’Éternel parle aussi sur Jézabel, et il dit : Les chiens mangeront Jézabel près du rempart de Jizreel. Celui de la maison d’Achab qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens, et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel." (Premier Livre des Rois, 21, 19-24). Et effectivement : "Alors un homme tira de son arc au hasard, et frappa le roi d’Israël au défaut de la cuirasse. Le roi dit à celui qui dirigeait son char : Tourne, et fais-moi sortir du champ de bataille, car je suis blessé.Le combat devint acharné ce jour-là. Le roi fut retenu dans son char en face des Syriens, et il mourut le soir. Le sang de la blessure coula dans l’intérieur du char. Au coucher du soleil, on cria par tout le camp : Chacun à sa ville et chacun dans son pays !Ainsi mourut le roi, qui fut ramené à Samarie ; et on enterra le roi à Samarie. Lorsqu’on lava le char à l’étang de Samarie, les chiens léchèrent le sang d’Achab, et les prostituées s’y baignèrent, selon la parole que l’Éternel avait prononcée." (Rois 1, 22, 34-38)
Ce passage permet de comprendre ce passage du chapitre XVI de Moby Dick :
—Oh ! ce n’est pas un capitaine Bildad, non, ni un capitaine Peleg ; il est Achab, mon fils ; et l’Achab de l’histoire, tu le sais, était un roi couronné !
– Et un roi très infâme. Lorsque ce roi pervers fut assassiné, les chiens ne léchèrent-ils pas son sang ?
2b. Élie.
Ayant fait connaissance avec le roi Achab, on ne s'étonne plus de voir apparaître Élie, sous le titre Un prophète du chapitre XIX, et comme oiseau de mauvaise augure élliptique et abscond du chapitre XXI. Nous aurions mieux connu notre Bible que nous aurions même attendu cette apparition dès la première mention du nom d'Achab, comme si, découvrant un héros de roman se nommant Tintin, nous aurions eu un plaisir complice en voyant arriver quelques pages plus loin un Haddock plus ou moins déguisé.
Élie, la mauvaise conscience d'Achab dans la Bible, est plutôt ici celle du héros Ismaël, qui est, qui va devenir un second Jonas.
2c. Jonas.
C'est, d'abord, le surnom du barman de l'auberge Au souffle de la baleine, petit homme ratatiné officiant à l'intérieur de l' " immense voûte osseuse d'une mâchoire de baleine" ; son surnom est donc onomastiquement transparent, mais contribue à faire rentrer le lecteur dans ce livre saturé monomaniaquement de cétologie.
Le héros biblique du Livre de Jonas, est par ailleurs le sujet dés le chapitre IX du sermon du père Mapple .
Moby Dick par John Huston, avec Orson Wells dans le rôle de Mapple:
 Voir le sermon du père Mapple sur You Tube
Voir le sermon du père Mapple sur You Tube
Or il se trouve que le roman va suivre le fil rouge des aventures de Jonas à partir du moment où celui-ci cherche à s'embarquer sur un navire sur le port de Jaffa, fuyant l'ordre qu'il a reçu de Dieu d'aller annoncer aux habitants de Ninive la destruction de la ville en punition de leurs péchés. Comme le dit le père Mapple, "Il croit qu'un navire construit par des hommes l'emportera vers des pays où Dieu ne règne pas mais dont seuls sont maîtres à bord les capitaines de ce monde". C'est une condamnation directe de l'hubris humaine, des prétentions de l'homme à se dire "maître et possesseur de la nature" et seul maître à bord sur la planète terre.
Or, le narrateur n'est-il pas un autre Jonas, qui nous dit qu'il embarque pour échapper à la dépression et à la tentation suicidaire ?
Lorsque le narrateur salue, sur le navire qui l'emporte vers Nantucket, "l'océan magnanime qui ne garde nulle trace", ne comprenons-nous pas qu'il recherche, dans sa fuite de tous les livres de compte, la clémence "magnanime", le pardon de toute cette comptabilité des péchés, l'abandon de la logique de tous les Bildad (cf infra) qui pensent que toutes les fautes doivent être expiées ? Sur la mer, les coupables ne laissent derrière eux aucune trace de leurs pas, ou de leurs crimes.
"Gaining the more open water, the bracing breeze waxed fresh; the little Moss tossed the quick foam from her bows, as a young colt his snortings. How I snuffed that Tartar air!—how I spurned that turnpike earth!— that common highway all over dented with the marks of slavish heels and hoofs; and turned me to admire the magnanimity of the sea which will permit no records." Nous gagnions le large, la brise vivifiante fraîchissait ; notre petit Goémon, tel un jeune poulain qui s'ébroue, faisait jaillir de son étrave des tourbillons d'écume. Ah ! Comme je humais ces souffles tartares. Foin de la terre et de ses barrières de péage ! foin de ces grands chemins où s'impriment les marques des talons et des sabots serviles! Comme je m'en détournais pour admirer l'océan magnanime qui ne garde nulle trace !" (Trad. P. Jaworski).
Et comment ne pas penser aux éléments biographiques de Melville ? Il me suffit de consulter Wikipédia pour lire : "À la fin de 1840, déçu dans ses espoirs à l'ouest, Melville se rend à Nantucket, berceau américain de la chasse à la baleine, où il signe, le 26 décembre, son inscription sur le rôle de l’Acushnet, trois-mâts baleinier de 358 tonnes (il reçoit une avance de 84 dollars sur son salaire) et embarque à New Bedford le 31 décembre. Il parcourt ainsi le Pacifique, visitant les îles Galapagos et les Marquises où il déserte, le 9 juillet 1842, avec un de ses compagnons d'infortune, Richard Tobbias Greene, le « Toby » du livreTypee (Taïpi), qui relatera son aventure sur Nuku Hiva*.
Le 9 août 1842, il réussit à quitter la vallée de Taipivai sur le baleinier australien Lucy Ann alerté par Richard Tobbias Greene et part pour Tahiti. À l'arrivée à Tahiti, il est arrêté pour avoir participé à une mutinerie à bord du Lucy Ann et est emprisonné. Il s'échappe de Tahiti pour rejoindre Moorea, puis Hawaii. Il travaille un temps comme commis chez un marchand puis s'engage comme simple matelot dans l'équipage de la frégate USS United States de la marine de guerre américaine qui débarque à Boston en octobre 1844."
* Aux Marquises, s'étant enfoncé à l'intérieur des terres, il est fait prisonnier par des cannibales ; il ne sera délivré que par l'équipage du Lucy Ann.
Concernant le patronyme Mapple, construit par fusion des mots anglais maple, érable, et apple, la pomme, je n'ai actuellement pas de commentaire à proposer.
2d. Peleg.
Achab, Peleg et Bildag, les trois capitaines de baleinier de Nantucket, ont des noms bibliques selon l'usage des Quakers.
Peleg est cité dans la Bible en Genèse 11, 16-19 : "Quand Éber eut trente-quatre ans, il engendra Péleg. Après la naissance de Péleg, Éber vécut quatre cent trente ans et il engendra des fils et des filles. Quand Péleg eut trente ans, il engendra Réu. Après la naissance de Réu, Péleg vécut deux cent neuf ans et il engendra des fils et des filles."
On trouve sur Wikipédia cette information :"Peleg is a common surname in Israel, also being the root lettering for sailing (lahaflig להפליג) and a military half-bivouac tent (peleg-ohel פלג אוהל). The meaning of Peleg in English is "brook", a little river."
2e. Bildad.
C'est le nom du deuxième propriètaire du Pequod, un Quaker férocément avare tout en ne cessant de lire la Bible qui condamne l'appât du gain. Son nom vient directement de la Bible, du Livre de Job, où il apparaît au chapitre 8. Il signifie "longue amitié" (Jaworski) ou "Dieu a aimé" (discussion ici) Cet "ami" de Job vient le convaincre de se résigner à son triste sort, qui ne saurait être que la conséquence, la juste rétribution de ses péchés, de même que ses filles et fils ont péri par leurs fautes : Job,8,4 : "Si tes fils ont péchés contre Lui, il les a livrés à leur péché". C'est le donneur de bonnes leçons de morales, celui qui, après un accident, saura vous rappeller l'importance de la prudence, ou venir vous voir à l'hôpital pour vous expliquer gentiment les régles de bonne santé qu'il observe, ou, après un vol, vous expliquer avec tact qu'il ne faut jamais faire ceci, qu'il faut toujours faire cela... Si vous glissez il saura vous recommander de mettre, comme lui, de bonnes chaussures et de ne jamais laisser trainer vos savonnettes. Au chomeur, il saura faire valoir l'importance des démarches de recherche d'emploi, et, au pauvre, il fera preuve de pédagogie sur la valeur du travail et des économies. C'est le WASP, le self-made-man qui sait que s'il a réussi, il ne le doit qu'à lui-même, mais que l'échec est toujours la conséquence d'un laisser-aller d'individus trop faibles. Dieu voit tout cela et en sa grande Sagesse, il donne à ceux qui ont, et retire à ceux qui n'ont pas. "Non, Dieu ne rejette pas l'homme intégre, et il ne protège pas les méchants" (8, 20)
Lorsque Job proteste de son innocence, Tsophar, qui appartient au même Club que Bildad, reprend le même discours (Livre de Job, 11) et reproche à Job de vouloir faire le raisonneur face à la Justice de Dieu. S'il est pauvre comme Job, c'est bien de sa faute, il n'a qu'à chercher un job.
Job rétorque "Au malheur le mépris ; c'est la devise des heureux. A celui dont le pied chancelle est réservé le mépris !".
Cette insolence des pauvres est insupportable et Eliphaz saura lui rabattre le caquet : "Ton iniquité dirige ta bouche, et tu prends le langage des hommes rusés".
Bildad le capitaine baleinier a été "élevé selon les règles les plus strictes du quackerisme de la secte de Nantucket" mais "manquait passablement de simple logique" : "bien que refusant, par scrupules de conscience, de porter les armes contre de terrestres envahisseurs , lui-même avait envahi, sans que rien puisse le retenir, l'Atlantique et le Pacifique, et bien qu'ennemi juré du sang versé, il avait pourtant, dans son manteau étroit, répandu à flot celui du léviathan. Comment le vieux Bildad, au soir contemplatif de sa vie, réconciliait-il ces faits dans son souvenir, je ne sais ; mais cela ne semblait pas l'inquiéter outre-mesure, et il en était très probablement venu à la conclusion sage et raisonnable que la religion d'un homme est une chose, et que ce monde positif en est une autre. Ce monde paie des dividendes".
Cet "Avare incorrigible" et "tyran implacable" est plongé, lorsque Ismaël vient discuter de son enrôlement et de sa part, dans la lecture de l'Évangile de Matthieu, chapitre 6 versets 19-21 : Ne vous amassez point de trésors sur la terre, où la mite et le ver consument, où les voleurs percent et cambriolent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel : là, point de mite ni de ver qui consument, point de voleurs qui perforent et cambriolent. Car où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. Et, tout en lisant, il offre à Ismaël la part de 1/777e, c'est-à-dire une misère.
Le chiffre de 777 semble, en propre, un chiffre biblique, et ce triple 7 n'est pas là par hasard : il appartient si ce n'est à l'onomastique, du moins aux chiffres choisis par l'auteur, non pour leur valeur comptable, mais pour une autre raison. Pourtant, ce chiffre ne correspond à rien d'autres qu'à l'âge atteint par Lamek, le père de Noé. C'est dans l'Évangile de Matthieu -encore- que Pierre interroge Jésus (Mat 18:21) :
« Seigneur, quand mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner ? Jusqu'à sept fois ? » Jésus lui répondit : « Je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à soixante-dix fois sept fois.
Ce chiffre symbolique du pardon inépuisable, de la clémence infinie apparaît, dans la bouche de Bildad l'ami de Job partisan de la punition éxacte des péchés comme dans celle de Bildad le capitaine avare et tyrannique comme le témoin du dévoiement de la religion, qui s'affiche et s'énonce extérieurement pour mieux en trahir les régles. Or ce chiffre 777 va s'inscrire sept fois sur la page de Moby Dick, sept fois de suite Bildad va trahir le livre saint qu'il tient dans la main, jusqu'à l'ignominie de l'argument " si nous rétribuons trop largement les services de ce jeune homme, nous enleverons peut-être le pain de la bouche à ces veuves et à ces orphelins" [qui détiennent quelques parts très minoritaires du navire].
2f. Ismaël.
a) Ismaël (en anglais Ishmael) est, sans ambiguïté, un nom biblique, celui du premier fils d'Abraham, obtenu de sa servante égyptienne Agar, et dont Dieu a promis qu'il donnerait naissance à douze princes et une grande nation. Le nom signifie en hébreu "Dieu a entendu" [ma demande], et si, dans la bouche d'Abraham, cela signifie "Dieu m'a accordé une descendance", cela peut aussi signifier pour un écrivain dont l'attente principale est le succès de son œuvre, "Dieu m'a donné la notoriété".
C'est le fruit de l'alliance conclue entre Dieu et Abraham.
L'orthographe du nom peut avoir son importance : Giono traduit l'américain Ishmael par Ismaël, et Armel Guerne par Ismahel, introduisant un "h". Il se trouve que le nom d'Abraham était, à Ür et avant la promesse du Pays de Canaan pour ses 99 ans, Abram , et qu'il se transforme par introduction de la lettre hébraïque hé : "On ne te nommera plus Abram, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations". (Genèse 17, 5).
Dans l'incipit de Moby Dick "Call me Ishmael", ce "h" peut, tout comme le nom lui-même et la tournure de phrase, fonder l'alliance, le pacte fictionnel que tout romancier passe avec son lecteur, et réciproquement. Cette alliance entre Dieu et Abraham est matérialisé par la circoncision, autrement-dit le manque, la privation symbolique et rituellement organisée, la cèsure, la castration symboligène, le fragment ôté, la pause (au sens musical), l'élision.
On retrouve ce h dans le nom Ahab (forme anglaise d'Achab)
On lit alors autrement la toute première Étymologie, qui restait mystérieuse, celle de Hakluyt : Elle est tirée de Principals Navigations lors d'un passage ou Richard Hakluyt dénonce la croyance dans les îles-baleines si grandes qu'un navire y jetait l'ancre, que son équipage y débarquait avec les victuailles, avant de provoquer la colère du monstre en faisant du feu... Il signale que les marins —ou les auteurs de fables— nommaient ces îles Trollwal, (décrit par Brendan, Olaus Magnus, Gessner, et Sébastien Münster, La Cosmographie universelle contenant la situation de toutes les parties du monde, livre IV, s.l., s.d. (trad. française, édition de 1575), p. 1053-1056 ). Si je comprends bien ce passage, Hackluyt semble s'en prendre à Sébastien Munster (qui était cartographe, historien, mathématicien et professeur d'hébreu) en lui reprochant de prétendre enseigner à des élèves sans être capable soit même de faire la différence entre whale, la baleine, et Trollwal oubliant le "h" qui fait la différence entre whale et wal : " Go not farther then your skil, Munster, for I take it you cannot skill our tongue : and therefore iy may be a shame for a learned man to teach others that which he knoweth not himselfe : for such an attempt is subject to manifold errours, as we well shew by this your example. For while you take in hand to schoole others, & to teach them by what name a Whale-fish is to be called in our tongue, leaving out throughignorance the letter H, which almost alone maketh up the signification of the worlde, you deliver that which is not true : for val in our langage signifieth not a whale, but chusing or choise of the verg Eg vel, that is to say I chuse,or I make choise, for what val is derived, etc... " J'ai souligné la citation donnée par Melville.
Parmi d'autres interprétations, cette citation à l'intérieur du livre de Melville peut être comprise comme illustrant le rôle du H, de la lettre non prononcée, mais qui par l'élision, crée le sens. Sans espace entre les mots, l'écriture est incomprehensible; sans respecter le H, le H de Whale, c'est la Tour de Babel, le chaos, la porte ouverte aux affabulations et mystifications, le mensonge. Et il est significatif également que, dans les citations de Melville, c'est le contexte omis (mais auquel l'auteur renvoie) qui révèle le sens caché.
A un autre niveau (le plus plaisant) ce H non prononcé mais essentiel, ce silence capital peut aussi être entendu comme le sens même de l'œuvre : that is true, ce qui est vrai ici est ce qui est écrit entre les lignes. Relisez celles qui décrivent Bildad lisant l'Évangile de Matthieu et proposant à Ismaël sa 1/777e part : rien n'est dit si clairement que d'être invisible. C'est la force de l'humour d'être impalpable, insaisissable, et Flaubert cherchait bien à écrire un texte où "le lecteur ne pourrait jamais savoir si l'auteur s'est foutu de lui". Ici, ce sont les personnages qui chercheraient en vain les mots qui les accusent ; si nous les entendons si bien, c'est qu'ils ne sont pas prononcés.
On peut voir une autre illustration de l'idée que la Vérité est dans l'élision dans la phrase : " Quiqueg était natif de Rokovoko, une île située très loin à l'Ouest et au Sud. Comme tous les endroits vrais , elle ne figure sur aucune carte." (p. 77)
S'il est d'abord signe de l'alliance, il devient, dans Genèse 21, après que Sarah ait donné naissance à Isaac et qu'Abraham ait dû chasser Ismaël et sa mère Agar dans le désert, une figure du fils réprouvé, déshérité par le père au profit d'un frère concurrent, solitaire, errant dans le désert, telle que la reprendra Fenimore Cooper dans La Prairie (1827) avec son personnage de Ismaël Bush : avec ce dernier prendra naissance la "thématique ismaëlienne" (Jaworski) faite d'exclusion sociale et de misanthropie.
3. Les noms de navire.
3a). Devil-Dam, Tit-Bit et Pequod.
Chapitre 16 : After much prolonged sauntering and many random inquiries, I learnt that there were three ships up for three-years' voyages—The Devil-dam, the Tit-bit, and the Pequod. DEVIL-DAM, I do not know the origin of; TIT-BIT is obvious; PEQUOD, you will no doubt remember, was the name of a celebrated tribe of Massachusetts Indians; now extinct as the ancient Medes. I peered and pryed about the Devil-dam; from her, hopped over to the Tit-bit; and finally, going on board the Pequod, looked around her for a moment, and then decided that this was the very ship for us.
...j’appris que trois navires étaient en partance pour des voyages de trois ans : le Diable-et-sa-mère, la Bonne-Bouche et le Péquod. J’ignore l’origine du nom du Diable-et-sa-mère, celle de Bonne Bouche est évidente, quant à Péquod, vous vous souvenez sans doute que c’était le nom d’une célèbre tribu d’Indiens du Massachussetts aussi éteinte à présent que les anciens Mèdes. Je jetai un regard inquisiteur et fureteur sur le Diable-et-sa-mère ; de là, je sautai dans la Bonne-Bouche et enfin, montant à bord du Péquod, je l’examinai un moment et décidai que c’était là le navire idéal pour nous.
Le nom de Pequod fait sa première apparition en compagnie de deux autres noms de navire encore plus curieux, Devil-Dam et Tit-Bit (que j'estime préférable de ne pas traduire dans le texte français).
— Melville se livre à un commentaire onomastique, profitons-en : "J'ignore l'origine du nom de Devil-Dam".
Pourtant, ce nom que l'on peut traduire par Le Diable et sa mère ou le Diable et sa femme est employé six fois par Shakespeare (Le roi Jean ; Titus Andr. IV,2,64 ; La Mégère apprivoisée I,1,105 et III, 2,155) par exemple dans cette dernière occurence : GREMIO :No, he’s a devil—a devil, I tell you! An utter fiend./TRANIO (as LUCENTIO) Why, she’s a devil, a devil, the devil’s dam. Traduction TRANIO.-Quoi ! plus bourru qu'elle ? Oh ! cela est impossible. GREMIO.-Bon ! c'est un diable, un vrai diable, un démon. TRANIO.-Eh bien !elle, c'est une diablesse, une diablesse, la femme du diable. C'est (mais je ne suis pas compétent) cette dernière traduction, La Femme du diable qui me convient le mieux pour désigner un navire baleinier dont j'imagine déjà la figure de proue.
Armel Guerne a traduit par le féminin de Satan : "La Satane".
Henriette Guex-Roll a traduit par 'Le Diable -et-sa-mère".
Philippe Jaworski a traduit par "La Diablesse".
— Tit-Bit ou titbit, dont le sens est présenté comme "évident" par Melville, désigne en anglais ou plutôt en américain ou anglais canadien une friandise, ou, au sens figuré, quelque chose de savoureux voire de croquignolet (un passage de Sade par exemple). Le dictionnaire Harper Collins donne : 1. (Cookery) a tasty small piece of food; dainty. 2. a pleasing scrap of anything, such as scandal. [perhaps from dialect tid tender, of obscure origin]. Je n'apprècie la traduction par Bonne Bouche qu'après avoir fait ce détour par le dictionnaire, qui me permet d'entendre l'expression au second degré, "garder pour la bonne bouche", les connaisseurs —et eux seulement— apprécieront. Comme il ne viendrait à personne l'idée de nommer un baleinier "Friandise", ou Bonne Bouche, il faut chercher mieux.
En 1881, un magazine britannique a porté le titre de Tit-Bits, raccourci du titre complet Tit-Bits from all the interesting Books, Periodicals, and Newspapers of the World, que je propose de traduire par Les Bonnes Pages [ ou Les Perles, ou mieux les Bons Morceaux] de tous les livres, périodiques et journaux interessants du monde entier. Là encore, il faudrait mieux ne pas traduire ce nom de navire, mais le comprendre à la lumière de ces exemples. A défaut , j'aurais opté pour La Perle (au second degré), joli nom pour une goélette ou un trois-mâts-barque, ou plutôt pour Le Sot-l'y-laisse..
Henriette Guex-Roll a traduit par "Bonne-Bouche".
Armel Guerne a traduit par "La Friandise".
Philippe Jaworski a traduit par "Bonne-bouche".
— Venons-en au Pequod : Melville indique cette-fois clairement l'origine du nom : celui d’une célèbre tribu d’Indiens du Massachussetts aussi éteinte à présent que les anciens Mèdes.
Les Pequots sont, selon l'encyclopédie Larousse, une nation indienne du Connecticut, "peuple d'agriculteurs et de pécheurs qui vivent dans des villages fortifiés faits de wigwams recouverts d’écorce. Leurs ennemis traditionnels sont les Narragansetts.
Les Anglais établis au Massachusetts depuis 1620 cherchent à s’emparer du territoire pequot. De nombreux incidents opposent durant plusieurs mois les Pequots aux colons. Au début de l’année 1637, des Pequots tuent neufs colons.
LE MASSACRE DE MYSTIC RIVER (1637)
Pour mettre fin aux attaques des Pequots sur les établissements anglais du Connecticut, les autorités britanniques décident de frapper un grand coup. Les Mohegans du chef Uncas se joignent aux troupes des capitaines John Underhill et John Mason. Le 26 mai 1637, ils se dirigent vers le village du chef Sassacus, l’un des deux grands villages fortifiés que possèdent les Pequots sur la Mystic River. Deux cents Narragansetts viennent grossir le nombre des assaillants.
Les Anglais et leurs alliés se heurtent à la solide palissade qui défend le village. Les Pequots résistent avec acharnement au feu des assaillants solidement armés de mousquets. Alors, le capitaine Mason fait lancer des torches enflammées sur les wigwams. Le village qui abrite six cents Pequots n’est bientôt plus qu’un immense brasier. Tous ceux qui tentent de fuir la fournaise sont abattus par les mousquets des Anglais. "C’était un spectacle terrible de les voir ainsi griller dans le feu que les flots de leur sang ne parvenait pas à éteindre", racontera l’un des officiers présents. Le capitaine Underhill fait remarquer que même les Narragansetts, pourtant rompus aux cruautés de la guerre indienne, sont épouvantés de la férocité des Anglais.
En moins d’une heure, les habitants du village indien sont morts. Le capitaine Mason s’écrie : "Dieu est avec nous : il se moque de ses ennemis et il en fait un brasier !". Mais, alors que les vainqueurs quittent les lieux, ils sont assaillis par deux cents guerriers pequots ivres de vengeance, venant de l’autre village. Les Narragansetts les tiennent à distance jusqu’aux abords de la colonie. La résistance des Pequots est définitivement brisée.
Terrifiés, les Pequots des autres villages se cachent dans les marais où les Anglais les assiègent. Ceux qui se rendent sont vendus comme esclaves. Les quelques survivants qui se cachent dans les forêts sont traqués par les Anglais et leurs alliés indiens. Les Mohegans capturent et assimilent certains d’entre eux. En 1640, la nation pequot a complètement disparu.
Quelques Pequots survivront pourtant. Ce sont les descendants des prisonniers esclaves
LE CASINO DE FOXWOODS
Dans les années 1970, des personnes d’ascendance pequot se font reconnaître par l’état fédéral un petit territoire sur la côte du Connecticut, près de Hanford. C’est là que les Pequots-Mastantuckets fondent, en 1992, le casino de Foxwoods, le plus grand casino indien des Etats-Unis. Maintenant, les Pequots sont riches. Ils vivent dans de belles maisons et donnent de l’argent au Musée des Indiens d’Amérique, ainsi qu’à de nombreuses fondations culturelles ou philanthropiques. Ils ont pu racheter une partie de leurs terres.
Chaque année, en septembre, à l’occasion de la Fête du Maïs Vert, ils organisent le plus grand "pow-wow" des Etats-Unis."
Je trouve quelques précisions supplémentaires :
a) le mot algonquien pequot a été jugé dériveant de Pequttôog, ou Paquatauoq qui signifie "Les destructeurs", ce qui ne manque pas de sens sous la plume de Melville pour baptiser son navire baleinier. C'était le sens admis au XIXe siècle, et ce n'est qu'au XXe siècle que Frank Speck, spécialiste du Pequot-Moheban (une langue actuellement éteinte), se prononça pour celui de "swallowness of a body of water (un plan d'eau de faible profondeur?)".

b) Il faut souligner que le Connecticut est voisin du Massachusetts, auquel appartient New-Bedford et Nantucket, et que la Colonie de Massachusetts Bay regroupait ces territoires . Le peuple pequot était, bien que le point soit discuté, indigène de cette région du Connecticut et comptait 16 000 personnes avant d'être décimés par une épidémie de variole (introduite par les colons) en 1633 qui réduisit leur nombre à 4000, puis par la guerre du Pequot de 1637. Le massacre du village de Missituck fut perpétué par les colons de Massachusetts Bay et de la colonie du Connecticut, et en 1638, les prisonniers pequots furent échangés par William Pierce contre une cargaison d'esclave de la Barbade
Voir : http://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_des_Pequots
: http://en.wikipedia.org/wiki/Pequot_people#Etymology_of_.22Pequot.22
: http://en.wikipedia.org/wiki/Pequot_War
Ces éléments soulignent la virulence de l'ironie de Melville en choisissant comme nom de navire pour les baleiniers de Nantucket qui se sont tournés vers l'océan comme nouveau territoire de colonisation et d'extermination des cétacés, le nom de la tribu indienne que leurs ancêtres avaient contribué à faire disparaître, et un terme qui signifie
Les Destructeurs..
3b) The Moss.
Une fois encore, fallait-il traduire le nom propre du "paquebot" qui fait le service entre New-Bedford et Nantucket ? Henriette Guex-Rolle traduit Moss par Varech, et Philippe Jaworski par Goémon, alors que la traduction litterale de Moss est "mousse, plante de l'embranchement des Bryophytes" et que goémon se dit "seaweed". Varech (le goémon d'épave) et Goémon ont plus de gueule que Mousse comme nom de navire, mais si Melville avait placé là une intention onomastique, celle-ci serait perdue pour le lecteur français. De même, serait perdue une hypothétique allusion à l'essai publié anonymement par Melville en août 1850 alors qu'il écrivait Moby Dick, Hawthorne and his Mosses. Il s'agissait d'une recension du recueil de nouvelles Mosses of the Old Manse (Les Mousses du Vieux Presbytère), écrit par Hawthorne. Melville, qui avait rencontré Hawthorne pour la première fois le 5 août lors d'un pique-nique s'enthousiasma pour cet auteur et se précipita à le lire, faisant publier son compte-rendu de lecture dans New-York World Literary magazin le 17 et 24 août.
La demeure historique The Old Manse à Concord dans le Massachusetts est liée au mouvement romantique américain nommé Transcendantalisme car l'œuvre phare de ce mouvement, Nature, y a été écrite par Ralph Waldo Emerson en 1836. Hawthorne et son épouse louérent la maison en 1842 dans le voisinage d'Emerson et de Henri David Thoreau, autre transcendantaliste, qui conçut l'aménagement du jardin. On peut croire que la maison et son jardin, situés au bord de la rivière Concord, devaient être riches en sous-bois moussus.
Mais ce mot de moss, qui revient trés souvent dans l'essai de Melville, (Hawthorne, "l'Homme des mousses") semble destiné à désigner métaphoriquement le tempérament sombre d'Hawthorne, si on en croit cet extrait : For spite of all the Indian-summer sunlight on the hither side of Hawthorne's soul, the other side—like the dark half of the physical sphere—is shrouded in a blackness, ten times black... You may be witched by his sunlight,—transported by the bright gildings in the skies he builds over you;—but there is the blackness of darkness beyond; and even his bright gildings but fringe, and play upon the edges of thunder-clouds. " Car en dépit de tout le soleil d'été indien qui baigne ce coté-ci de l'âme de Hawthorne, l'autre coté,—comme la moitié obscure d'une sphère physique—est enlinceulée d'une noirceur dix fois plus noire... Vous pouvez être ensorcelé par son soleil, transporté par les brillantes dorures des cieux qu'il construit au-dessus de vous; mais par delà s'étend l'obscurité des ténèbres ; et même ses brillantes dorures ne font que se jouer sur la frange d'orageuses nuées" (trad. P. Leyris, in Edition Pléiade de Melville, Œuvres III).
Cette obscurité de sous-bois, cette pénombre des mousses et des fougères n'est pas vantée pour elle-même, mais pour la faculté que l'écrivain y trouve de s'y cacher pour révéler la vérité : "Car dans ce monde de mensonges, la Vérité est forcée de fuir dans les bois comme un daim blanc éffarouché, et c'est seulement par d'habiles aperçus qu'elle se révèlera, comme chez Shakespeare et d'autres maîtres du grand Art d'énoncer la Vérité —même si c'est à mots couverts et par bribes." (Hawthorne and his Mosses, trad. P. Leyris). Nous retrouvons ici le théme de la vérité qui ne s'exprime qu'entre les lignes, sous le couvert des mots, cette Vérité qui rendait le "h" de Whale si important, de n'être qu'un effet de langue. (cf supra Ismahel)
Edgar Poe dira d'Hawthorne "il traite tous les sujets sur le même mode, en demi-teinte, brumeux, rêveur..." : Hawthorne et ses mousses... Entre Ombragé et Ombrageux.
Si, après avoir découvert ces éléments, je me remémore que le roman Moby Dick est dédié à Hawthorne, si je lis alors dans l'édition de la Pléiade que Moby Dick a été profondément remanié par Melville après qu'il ait écrit cet Hawthorne and his Mosses* , je deviens convaincu que le nom de ce bateau est un hommage littéraire crypté, auxquels seuls les lecteurs de la version originale auront accès, les autres risquant de glisser sur le Varech ou le Goémon et de passer outre.
*Moby Dick traduit et commenté par Jaworski, Melville en Pleiade, Œuvres III p. 1345 : "...le roman [...] a subi, dans les mois qui ont suivi , une métamorphose ou simplement une expansion ou une forte accentuation épique et tragique".
— J'avais commencé cette recherche sans même savoir le sens du mot Moss, mais je découvre que la rencontre avec Hawthorne, la lecture de Mosses of the Old Manse, et la rédaction de Hawthorne and his Mosses furent des éléments déterminants, bouleversants et féconds pour Melville, tant dans la fascination équivoque, presque érotique et du moins fraternelle exercée par Nathanael Hawthorne que dans la révélation de la puissance tragique, shakespearienne de l'œuvre à venir. Je cite Jaworski :
" Ce que Melville reconnaît en Hawthorne, par une fascination immédiate, violente, passionnée, où l'affect a une placeessnetielle, c'est, soudain incarnée, une figure familière de sa mythologie intime, qui projette son ombre de manière obsédante dans tous ses livres depuis Taïpi : la figure complexe, —parfois distribuée entre plusieurs personnages —du compagnon d'aventure, ami et frère, (et amant rêvé, peut-être) avec lequel le narrateur entretient une relation presque gémellaire ou "siamoise", pour reprendre un terme que Melville affectionne. La différence d'âge confère en outre à Hawthorne, de quinze ans son aîné, une forme d'autorité quasi paternelle, non pas de celles qui écrasent, mais au contraire rassurent, légitimisent et permettent un dialogue libérateur avec l'autre, et surtout, dans pareil jeu de miroir, avec soi-même" (Pleiade, Notice, p. 1145).
3c. The Goney (Albatross).
Ce navire est mentionné au chapitre 52, dont le titre est The Albatross, "L'Albatros" (p. 267). Melville a eu auparavant, page 218, dans une note de bas de page, l'occasion de signaler que l'albatros est surnommé goney par les marins. Un site signale l'appellation conjointe de gooney-bird. Philippe Jaworski, dans sa note 3 de la page 218, explique que l'adjectif signifie "idiot", "sot", qualifiant sans-doute le manque d'expressivité de l'oiseau lorsqu'il escorte un navire en planant sans bouger la tête ni cligner des yeux ; il traduit l'adjectif par "benêt", en s'inspirant, écrit-il, "du nigaud, appellation familière du petit cormoran d'allure lourde et maladroite". Dés lors, il est amené à traduire le nom du navire par "Le Benêt", ce qui manque un peu d'allure marine. Dans sa description, Melville insiste surtout sur la couleur blanche du navire, et semble donc faire plutôt un lien avec le mot albatros et son étymologie fantaisiste issu du latin albus, "blanc" : "On eût dit le squelette d'un morse échoué, blanchi par les vagues comme par des foulons. Sur toute la hauteur de ses flancs, cette apparition spectrale était maculée de longues trainées de rouille aux reflets rougeâtres, tandis que ses espars et son gréement étaient pareils à d'épaisses branches enveloppées d'une fourrure de givre." Après que le capitaine, "penché sur le pavois blafard" , ait laissé tomber son porte-voix, l'Albatros va s'éloigner et disparaître, ombre fantômatique et de mauvaise augure.
Henriette Guex-Rolle traduit par The Goney par "Le Diomède".
3d) The Town-Ho (Chapitre 54).
De ce baleinier, seule l'histoire sera contée, à l'auberge The Golden Inn (l'Auberge Dorée) de Lima, mais une astérisque acollée au nom de Town-Ho! nous expliquera que "Tel est le cri que poussaient autrefois les vigies à la pomme de mât des baleiniers lorsqu'ils apercevaient les cétacés : il est encore en usage chez les baleiniers lorsqu'ils chassent les fameuses tortues des Galapagos". Il est fort peu probable que jamais navire baleinier de Nantucket ou d'ailleurs ne s'affubla d'un tel nom, et il faut plutôt voir là un effet de l'aimable effort de l'auteur pour plonger son lecteur, qu'il présume aussi peu salé qu'un fermier de l'Illinois, dans le bain linguistique des harponneurs de baleines. Lorsqu'il ne lance pas sa ligne onomastique dans la Bible du bon roi Jacques, il va ferrer ses prises dans ses meilleures encyclopédies sur la pêche baleinière.
Henriette Guex-Rolle traduit par "Le Town-Ho!", dans lequel l'oreille française entend mal à propos "le tonneau", alors que Jaworski traduit par "Holà, ho!"
3e) The Jeroboam. (chapitre 71)
Traduction unanime : "Le Jéroboam".
Nous retrouvons ici le nom d'un roi d'Israël, un prédécesseur du rois Achab puisqu'il fut, de tous les rois d'Israël, le premier. Contestant au successeur désigné de Salomon la légitimité de son pouvoir, il prit la tête de dix tribus qui créèrent le royaume du Nord, laissant au sud le royaume de Juda avec deux tribus,sur lequel régnait Roboam. S'il est un trait commun entre le roi Achab et Jéroboam, c'est que tous les deux se rendirent désagréable à Yahvé : Jéroboam, soucieux de donner à son nouveau royaume son indépendance, alors que les tribus avaient perdu le lieu de culte de Jérusalem, appartenant au royaume de Juda, fonda deux nouveaux sanctuaires à Dan et à Bethel et y plaça deux veaux d'or.
Jéroboam et Achab sont des rois impies adorateurs d'idoles, et qui repoussent les prophètes de Dieu leur envoie ; en baptisant de leur noms les baleiniers américains commandités par les quakers, Melville mène clairement la métaphore qui condamne, dans la chasse aux cétacés, une société avide de profit, adorant les veaux d'or et trahissant des alliances ancestrales.
Nous ne sommes pas étonnés que ce nom de navire soit attribué à un baleinier de Nantucket.
3f) The Virgin. (chapitre 81)
Ce navire de Brême porte un nom allemand, Jungfrau ("La Jeune Fille") que Melville traduit par The Virgin ("La Vierge"); Philippe Jaworski traduit Virgin par "La Pucelle" ; Henriette Guex-Rolle et Armel Guerne traduisent par "La Vierge".
Melville justifie son choix onomastique par une plaisanterie un peu lourde : comme ce baleinier allemand n'a pas réussi à pêcher la moindre baleine et qu'il n'a même plus d'huile pour sa propre consommation, l'auteur donne la parole à son capitaine, qui est monté à bord avec sa burette vide : " Son navire, dit-il en conclusion, était bel et bien ce qu'on appelle techniquement parmi les pêcheurs un navire "propre" (c'est-à-dire vide), qui méritait tout-à-fait son nom :le Jungfrau, ou la Pucelle." (p.389).
Le nom du capitaine, Derick De Deer, mériterait peut-être une réflexion onomastique.
3g. The Rose-Bud. (Chapitre 91).
Melville donne en anglais le nom de ce navire français, le Bouton-de-Rose, nom qu'il n'a inventé qu'à la seule fin de se moquer de "this Crappoes of Frenchmen", ces "crapauds" ou grenouilles de Français qui, aussi piètres chasseurs que les allemands du Virgin, aussi incapables de se procurer même l'huile de leur propre éclairage, aggravent leur cas en chassant, dans une puanteur pestilentielle, les baleines mortes. C'est une scène de comédie où les américains roulent dans la farine le capitaine français, ancien fabricant d'eau de Cologne, par le truchement du second qui, étant de Guernesey, mérite d'être mieux traité et de se faire dépouillé seulement du précieux ambre gris de la baleine que Bouton-de-Rose a capturé.
On voit que les Européens auraient de bonnes raisons de se plaindre de la façon dont ce roman les traite...si, en cette matière, la victime d'un mauvais tour ne rendait pas régulièrement la monnaie de la pièce au tour suivant.
2g. The Samuel Enderby. (Chapitre 100).
Traduction: Le Samuel Enderby.
L'explication onomastique ne restera mystérieuse que jusqu'au chapitre 102, dont le début est consacré à donner les renseignements nécessaires sur la société d'armement Samuel Enderby & Sons, très connue au XIXe siècle et à laquelle Edgar Poe fait allusion dans Les aventures d'Arthur Gordon Pym de Nantucket (1838).
Samuel Enderby (1717-1797) est le fondateur de cette société qu'il céda à ses trois fils Samuel, Georges et Charles. Elle armait 17 baleiniers en 1785, 68 navires en 1791. Les informations données par Melville ( et qui'l a trouvé dans l'ouvrage de Thomas Beale The Natural History of the Sperm Whale) sont vérifiées :
- Armement de l'Amelia, navire commandé par le Capitaine James Shields qui franchit le Cap Horn pour chasser la baleine dans l'Océan Austral. Le commandemant des navires d'Enderby était confié à des américains, qui composaient également l'équipage, et c'est un certain Archelus Hammond de Nantucket qui tua le premier cachalot il au large des côtes du Chili le 3 Mars 1789. Amelia est retourné à Londres le 12 Mars 1790 avec une cargaison de 139 tonnes de l'huile de baleine .
- Le 3 Août 1819, le navire baleinier Syren , détenue par Samuel Enderby & Sons et commandé par le capitaine Frederick Coffin de Nantucket, dans le Massachusetts , a visité les lieux de chasse hors du Japon . Le navire est retourné à Londres le 21 Avril 1822 avec une cargaison de 346 tonnes d'huile de sperme.
- La participation de l'armement Enterby aux campagnes d'exploration de l'Océan et des Terres Australes est également confirmé, comme l'atteste, par exemple, le nom de Terre Enderby donné, en territoire antarctique australien, à la terre qui s'étend du glacier Shinnan à la Baie William Scoresby : Elle a été découverte en février 1831 par John Biscoe et fut nommée d'après les Frères Enderby de Londres, les propriétaires du navire utilisé, le Tula.
Melville ne se trompait pas lorsqu'il présumait, en 1851, que "la maison existe encore aujourd'hui", mais la faillite fut prononcée en 1854.
Le baleinier Samuel Enderby a réellement existé, Jaworski nous révélant par une note de la page 485 qu'il fut construit en 1834, et qu'il n'est pas impossible que Melville ait "gamé" avec lui lors de ses navigations.
On trouve dans les Mémoires de l'Académie de médecine Volume 5, un mémoire de M. Keraudren intitulé Des propriétés du Sublimé corrosif pour la conservation du bois (p. 41), où il présente les résultats des travaux sur l'intérêt du deutochlorure de mercure par une commission de cinq membres nommés par M. le Ministre de la Marine et des Colonies. J'ai déjà eu partiellement à traiter du délicat problème de la conservation des matières organiques dans mes articles consacrés à la taxidermie Taxidermie et collections ornithologiques au XVIIIème et XIXème sièces. (1) et à la conservation des collections naturalistes ramenés par les navires d'exploration au XVIII et XIXe siècle. Les mêmes difficultés se présentent aux marins qui veulent préserver la toile des voiles, le chanvre des cordages, ou le bois des structures. L'acide sulfurique fut proposé, avant de réalisé qu'il corrodait les pièces métalliques ; puis diverses huiles végétales et animales. Un méthode éprouvée depuis Duhamel du Monceau consiste à faire mariner les bois dans l'eau de mer et/ou de les enfouir dans la vase, en les soumettant à l'alternance des marées : c'est l'origine, par exemple à Brest, des Parcs à Bois du fond de la Penfeld, des anses de Rostellec et de Kerhuon, copié à Lorient à Keronou. Les anglais tentèrent d'appliquer sur les bois de la Reine Charlotte, vaisseau de cent canons lors d'un radoub à Plimouth, "une espèce de marcassite "riche en arsenic, avant de constater un tel "engorgement des glandes" des ouvriers que deux d'entre eux en moururent. Là où l'Arsenic avait échoué, il fallait essayer le Mercure, remède à tout faire de l'époque, qui faisait merveille dans la syphilis, remplissait les thermomètres et les dents cariées (depuis 1850), s'appréciait comme antiseptique cutané (mercurochrome®), etc... Notre auteur Keraudren aborde donc cette riche idée dans une deuxième partie, "De l'emploi du sublimé corrosif pour prévenir la carie sèche ou pourriture du bois et de son influence sur la santé des ouvriers et des marins". C'est dans celle-ci qu'il écrit, page 61, les lignes suivantes : " Le navire baleinier Le Samuel Enderby de cinq cent cinquante tonneaux et de trente-trois hommes d'équipage a été construit à Cowes, dans les chantiers de Mr. Wite. Sa charpente est entièrement préparé au sublimé, ses voiles et ses cordages ont subi la même préparation ; néanmoins les hommes qui ont travaillé à sa construction et à son gréement n'ont éprouvé aucune espèce d'accident, et ceux qui se blessèrent fortuitement furent promptement guéris. Ce bâtiment alla terminer son équipement à Londres, et les marins qui avaient mangé et couché à bord pendant environ deux mois avant le départ pour la pêche à la baleine, restèrent en parfaite santé. Si l'équipage de l'Enderby est en aussi bon état à son retour, ce sera sans-doute une expérience bien concluante en faveur de l'innocuité du sublimé corrosif."
Oui, l'équipage de l'Enderby était en bonne santé, et au retour d'une aimable croisière de 29 mois dans les Mers du Sud (voisinant les degrés 1 à 5 de latitude Sud dans les Southern Fisheries) les différents témoignages du capitaine, de son second ou des armateurs étaient unanimes à chanter les mérites du "Procédé Kyan".
On eut aussi l'idée d'utiliser les excellentes propriétés du mercure pour la conservation des graines de semence : voilà ce qu'en dit un rapport Piren-Seine de 2004:
Un grand nombre de composés de mercure ont été utilisés pour le traitement des graines, notamment celles des céréales, avant les semailles. Régulièrement des accidents liés à l'utilisation de ces graines pour la fabrication de farine et de pain a entraîné l'intoxication de populations (en Irak en 1956, 1960 et 1972, provoquant la mort de centaines de personnes et l'empoisonnement de plusieurs milliers d'autres. Des intoxications humaines similaires ont été enregistrées en 1961 au Pakistan, en 1963, 64 et 65 au Guatemala) (Bakir 1973). La Suède, qui utilisait à grande échelle des dérivés alkyl du mercure pour le traitement des graines, a par ailleurs montré comment la toxicité de ces graines avait provoqué la mort de nombreux oiseaux et de leurs prédateurs. Ces deux types d'événements ont participé au même titre que Minamata à la prise de conscience des dangers du mercure dans la deuxième moitié du XXe siècle. Au début du XXe siècle, le sublimé corrosif ou bichlorure de mercure était utilisé pour combattre les maladies cryptogamiques de la vigne et en particulier le black rot (Bouchonnet 1909, p.285). L'Angleterre a commencé à produire des dérivés organiques du mercure (essentiellement du diméthyl mercure) pour leur utilisation comme fongicide en 1914 (Hamilton 1949, p.113). Mais ce commerce ne s'est véritablement développé qu'à partir des années 1930 (Hunter 1975, p.315). A la suite des accidents des années 1960, l'utilisation des composés mercuriels pour traiter les semences a progressivement disparu. Les composés organo-mercuriques entraient également dans la composition de fongicides destinés à combattre les moisissures de la pâte à papier. La France a publié une circulaire le 5 janvier 1976 pour interdire tout usage de biocides mercuriels dans les papeteries, une directive européenne a prohibé l'utilisation d'anti-parasitaires mercuriels en 1979 (directive européenne 79/117) et la France a supprimé toutes les dérogations à cette directive en 1989.
On sait que les chapeliers qui utilisaient le mercure pour traiter les feutres, et qui respiraient les vapeurs mercurielles, "travaillaient du chapeau" et devenaient fous : c'est le modèle du chapelier d'Alice au Pays des Merveilles. Melville nous signale bien que le chirurgien du Samuel Enderby était atteint d'hydrophobie ; mais, renseignement pris, ce symptome est très courant dans la marine, notamment anglaise qui s'adonne...au thé. Il n'appartient pas à la sémiologie de l'intoxication mercurielle, tout au plus à celle de la Rage, dont il est un signe précoce, mais qui se transmet par les renards, assez rares sur les bâtiments de sa Majesté. Le sublimé corrosif n'est pour rien responsable, à notre connaissance, du comportement de Jack Labonde.
N'est-il pas possible par contre que le Capitaine Achab ait navigué sur un navire soigneusement traité au sublimé ?
Le Samuel Enderby a été construit par Thomas White à Cowes (île de Whight) en 1864 ; ce baleinier gréé en 1851-52 en trois-mâts barque, de 422 tonneaux en ancienne jauge, 395 tonneaux selon la jauge moderne, enregistré à Londres, avait une carène doublée de cuivre. Il avait été réparé et réaménagé pour ses suprastructures en 1847. Ses propriétaires furent la Société Enderby, puis en 1851 la compagnie South Sea Whaling, puis la Southern Whaling and Fishing Compagny. Il a été commandé par les capitaines suivants : William Lisle de 1836 à 1840 ; Watson de 1840 à 1844 ; Georges Gerre puis Charles Freeman en 1847 ; Joseph William Miller* en 1847-1849 ; Henderson de 1849 à 1852; Oliver de 1853 à 1854, date à laquelle il disparaît des registres de la Lloyds (Lloyds Register of Shipping). Il navigua sur la ligne Londres-Cowes, puis à l'île Maurice en 1851-52, puis dans les mers du Sud.
* second sur Samuel Enderby sous le commandement de W. Lisle.
Melville navigua sur des baleiniers de 1840 à 1842 : s'il a rencontré le Samuel Enderby, celui-ci était sous le commandement du Capt. Watson; s'il en a entendu parler avant et pendant la composition de Moby-Dick, le navire était alors sous le commandement des capitaines suivants. En 1836, le chirurgien du Samuel-Enderby se nommait Charles Penny : en 1867, il était signalé, à Hobarth, comme passager sur l'Alexander-Henry (The Sydney Monitor Lundi 13 Février 1837). Je n'ai pas retrouvé les noms des autres chirurgiens.
La South Sea Whaling Compagny a été créée par octroi à Charles Enderby d'une chartre royale l'autorisant à établir sur les îles Auckland une station baleinière permanente et une colonie. En effet, l'entreprise familiale Enderby était en déclin à la suite de pertes occasionnées par plusieurs expéditions ambitieuses dans l'Océan Austral, et surtout aprés l'incendie qui avait détruit en 1845 leur Corderie du quartier londonien de Greenwhich, Enderby's Hemp Rope Works. Pour sauver l'entreprise, Charles obtint une aide du gouvernement pour créer cette colonie, permettant aux baleiniers de caréner et de décharger leur cargaison. Charles Enderby fut nommé lieutenant-général des îles Auckland. En décembre 1849, il mena une expédition composée de trois navires transportant 150 colons, un chirurgien un ingénieur civil, des menuisiers de marine et divers animaux de fermes qui débarquèrent à Port Ross. Ils eurent la surprise d'y découvrir 70 maoris et leurs esclaves morioris. Les terres furent défrichées et la station baleinière montée, disposant de huit navires, mais le climat froid, les précipitations excessives, la nature aride des sols, et l'absence de baleine capturée mena le projet à l'échec ; la colonie, baptisée Hardwicke, fut abandonnée en août 1852 par Charles Enderby, qui regagna Londres. L'entreprise familiale fut liquidée en 1854, et lui-même décéda dans la pauvreté le 31 août 1876. Quand aux îles Auckland, elles sont restées inhabitées. L'île la plus au nord de l'archipel porte le nom d'île Enderby.
Dans cette aventure des îles Auckland, le Samuel Enderby, commandé par Henderson appartient, avec le Fanny et le Brisk à la liste des trois navires qui, partis de Plimouth le 17 août, appareillèrent de Nouvelle Zélande en décembre 1849 : Charles en personne était à bord du "Sammy", avec 40 "mecanics" (mécanicien-monteur ?) et leur famille.
quelques sources :
l'incendie de la corderie et Enderby House.
Geoges Glazer Gallery : THE SAMUEL ENDERBY, OF 422 TONS, WILLIAM LISLE, COMMANDER LEAVING COWES ROADS FOR LONDON, SEPT. 1834 par William Huggins

Interessons-nous maintenant aux patronymes des officiers du Samuel-Enderby :
Le capitaine se nomme Boomer (Traduit par "Florissant" par Jaworski, ). Le second se nomme Mounttop ( "Duhaut-Dumont" par Jaworski, ). Le ton débridé du capitaine et du chirurgien laisse présumé qu'une intention se cache derrière ces noms saugrenus, mais les patronymes choisis en traduction n'aident pas mon imagination à créer les associations libres nécessaires. Armel Guerne a choisi de conserver les noms de Boomer et de Mounttop. Henriette Guex-Rolle également, mais elle orthograpjhie "Mountop". Quelle astuce Melville y a-t-il caché ? Mounttop, "Monte-la-d'sus" ? Boomer, "l'Explosif" ? ou bien "Et qu'ça saute?".
Le chirurgien se nomme Jack Bunger (Traduction "Jack Labonde" par Jaworski, "Bunger" par H.G.R). Son nom fait l'objet d'une note dans l'édition critique Norton de 2002 : " One who puts the bung (plug) into a cask of liquide, or (the case here), who pulls is out. The name signals the unreliability of the surgeon's claim to be a total abstinence man". "La bonde" se rapporte donc au tonneau, ou à la bouteille, que Bunger ne sait pas boucher ; néanmoins, comme d'autres noms de cette onomastique melvillienne, il semble que d'autres sens moins convenables pourraient être devinés, et que les trois noms de Boomer, Mounttop et Bunger soient de connivence.
Bunger pourtant un patronyme authentique, et si, en Antarctique, une chaîne cotière a été baptisée Bunger Hills, c'est pour avoir été photographiée par l'avion de reconnaissance de l'U.S Navy pilotée par David E. Bunger (en 1947).
Armel Guerne a traduit par "Jack Bondon".
3h) The Bachelor. (Chapitre 115).
Traduction: "Le Célibataire", navire de Nantucket. Drôle de nom, que peut-il vouloir dire ici ?
3i). The Rachel (Chapitre 128 Le Pequod rencontre la Rachel)
"La Rachel" est le nom d'un navire baleinier commandé par le capitaine Gardner, de Nantucket, un ami d'Achab. L'onomastique du nom du navire est claire, car lorsque le Pequod rencontre la Rachel, ce baleinier vient de perdre, la veille, une baleinière et son équipage, parmi lequel se trouve le propre fils de Gardner : ce dernier supplie donc Achab de participer aux recherches, mais Achab refuse avec d'autant plus de détermination qu'il vient d'apprendre que c'est Moby-Dick qui a entraîné la baleinière de la Rachel à sa perte.
En effet, "Rachel (hébreu רָחֵל (raḥel) : brebis), personnage biblique de la Genèse, est la cousine et la seconde femme de Jacob : elle lui donne ses deux derniers enfants, Joseph et Benjamin, mais meurt des suites de cette dernière naissance. Sur son tombeau, à Béthlém, Jacob dresse une stèle (Genèse 35, 16-20) qui commémore autant la naissance inespérée du fils que la mort de la mère. Bien des siècles plus tard, Saül, descendant de Benjamin, reçoit l'onction de roi. Il est le premier messie royal d'Israël. Aussitôt le prophète Samuel l'envoie au tombeau de Rachel (1 Samuel 10, 1-2). Les premiers pas du premier messie le portent vers le tombeau qui rappelle qu'un fils est sorti vivant contre toute attente.
On ne voit là aucun rapport avec le chapitre où la Rachel tire des bords dans le Pacifique à la recherche de l'équipage de la baleinière. C'est la citation de l'évangile de Matthieu, qui cite le prophète Jérémie, qui est explicite : "Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère, et il envoya tuer tous les enfants de deux ans et au-dessous qui étaient à Bethléhem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie, le prophète: « On a entendu des cris à Rama, Des pleurs et de grandes lamentations: Rachel pleure ses enfants, Et n'a pas voulu être consolée, Parce qu'ils ne sont plus. » " La citation de Jérémie 31:15, qui annonce la déportation des enfants d'Israël à Babylone, est la suivante :"Ainsi parle l'Eternel: On entend des cris à Rama, Des lamentations, des larmes amères; Rachel pleure ses enfants; Elle refuse d'être consolée sur ses enfants, Car ils ne sont plus." (Ramah est une ville du territoire de la tribu de Benjamin, ville où est né Samuel ).
C'est donc uniquement sur le plan métaphorique et prophétique lié au massacre des Innocents et à la destruction de Jérusalem que Rachel, qui mourut en réalité avant ses enfants, peut être décrite comme une mère pleurant ses enfants, et ne pouvant être consolée.
Le thème de la mort des enfants a déjà été évoqué par la figure du forgeron Perth, qui, par sa faute, a conduit ses enfants à la mort. Lorsqu'il forge, les étincelles qui tourbillonnent autour de son front sont comparés à des pétrels tempête, âmes défuntes suivant inlassablement les navires. Les marins les surnomment Mother Carey's childrens, les enfants de la Mère Carey.
La Rachel possède une place majeure dans le récit puisque le nom de ce navire apparaît à la dernière phrase de Moby-Dick, dans l'Épilogue : "Le second jour, une voile parut, s'approcha, et me recueillit enfin. C'était la Rachel à la course errante : ayant rebroussé chemin pour continuer de chercher ses enfants perdus, elle ne trouva qu'un autre orphelin."
On voit combien est polyvalente la figure de Rachel dans la Bible et dans le roman : mère mourrant en donnant la vie ; mère pleurant ses enfants perdus : mère errant à leur recherche ; mère en dernier lieu salvatrice du héros Ismaël. Du deuil d'une mère, puis du deuil d'enfants, on termine par le mot "orphelin". Herman Melville avait perdu son père à l'âge de 12 ans.
3j) The Delight. (Chapitre 131)
Traduction "La Joie." (Henriette Guex-Rolle), "Le Délice" (Armel Guerne), "Le Délices" (Jaworski).
Le nom du navire est commenté par le texte : "and another ship, most miserably misnamed The Delight, was descried", ce que Armel Guerne traduit littéralement et fidélement par par "Un autre vaisseau, qui portait misérablement son nom de "Délice"", alors que Jaworski choisit : "L'on signala un autre navire, malencontreusement appelé Le Délices."
Du point de vue du narrateur, le nom du navire est malencontreux, puisqu'après le Rachel et sa baleinière perdue, Le Pequod qui poursuit avec acharnement le cachalot blanc rencontre une autre navire baleinier victime de Moby-Dick, et qui s'apprête à immerger le cadavre d'un des six matelots tués la veille par le cétacé. Mais du point de vue de Melville, qui a précisément choisi ce nom parmi tant d'autres, il est parfaitement approprié à son dessein. Résoudre les raisons de ce choix permettrait de mieux comprendre le dessein, et, a contrario, connaissant par ailleurs le dessein melvillien, nous pouvons présentir les raisons du choix.
J'ai consulté le dictionnaire (Online Etymology Dictionary) : "delight (n.) c.1200, delit, from Old French delit "pleasure, delight, sexual desire," from delitier "please greatly, charm," from Latin delectare "to allure, delight, charm, please," frequentative of delicere "entice" (see delicious). Spelled delite until 16c. when it changed under influence of light, flight, etc. "
On trouve donc la notion de jouissance, et de jouissance sexuelle (il ne serait pas diificile de souligner combien celle-ci sous-tend l'œuvre) , celle de charme (envoûtement d'Achab, qui s'accroît face aux prouesses combattives de son adversaire), et on y trouve souligné aussi la contamination du mot par light, "lumière" (l'une des clefs du roman étant l'opposition entre Bien et Mal, Lumière et Obscurité, Dieu et Satan, Naissance et Destruction, etc...) et surtout fight, "combattre".
L'interprétation la plus simple du nom de navire est d'y voir un effet d'oxymore, les 'délices" annoncées se révélant funèbres, et la chasse glorieuse du "Maître-et-comme-possesseur-de-la-nature" virant au piteux cauchemard, pour ceux que n'exaltent pas les fièvres d'un défi faustien ou prométhéen. Mais, sans que je puisse aller plus avant, il me semble que le nom ne vaut pas que par son contraire : de vrais délices, puissamment sexuels et puissamment jouissifs (les "suppliciantes délices" A. Gide), sont aussi en jeux, et lorsque Melville s'accuse d'avoir créé un nom "most miserably misnammed", il les dissimulent habilement, tout en les énonçant toutes voiles dehors.
Qu'aurais-je choisi pour traduire Delight : "Ravissement", pour le double sens du mot "ravir" ?
3. Autres noms.
Les officiers:
Starbuck : " Nom d'une célèbre famille quaker de baleiniers établie à Nantucket au XVIIe siècle. Mary Starbuck, dont la jeune femme du seond porte le prénom, avait contribué à propager la foi quaker au début du XVIIIe siècle en créant la Société religieuse des Amis. Thomas Starbuck est l'un des personnages du roman de Joseph C. Hart Miriam Coffin." (P. Jarowski, op. cité p. 1204).
La marque de café Starbucks a été créée en 1971 à Seattle par Jerry Baldwin, professeur d'anglais, Zev Siegel, professeur d'histoire, et l'écrivain Gordon Bowker, tous trois passionnés de café et soucieux de témoigner du passé maritime du négoce du café. Gordon Bowder proposa de nommer la marque du nom du baleinier de Moby-Dick, mais Terry Heckler, créateur du logo, a rétorqué "Mais personne ne boira une tasse de Pee-quod !". Les associès remuèrent leurs méninges, et c'est le nom du premier lieutenant du bord qui en sorti, Starbuck.
Le premier logo se compose d’un cercle – rappelant un hublot – de couleur marron au centre duquel trône une sirène couronnée avec deux queues et la poitrine apparente Le choix de la sirène comme mascotte, et plus largement de toute l’imagerie maritime qui accompagne la société, s’explique par ses racines profondément ancrées dans la mer : « Nous voulions évoquer la tradition des voyages maritimes qui a accompagné l’histoire des premiers exportateurs de café, ajoute Steve Barrett. Cela a amené Terry Heckler à se tourner vers de vieux ouvrages de marine pour y puiser son inspiration. Ainsi il a basé son design sur une gravure scandinave datée du 16ème siècle représentant la figure d’une sirène. Pour ce qui est de la riche et profonde couleur brune du logo, elle fut choisie pour rappeler la nuance chaude des grains de café torréfiés. Et ces nuances de marron sont effectivement très vite devenues le symbole du café aux yeux des milliers de buveurs de café en Amérique du Nord. » Voir toute l'histoire du logo.
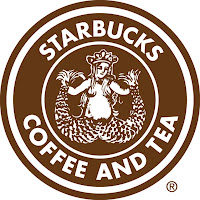
Stubb :
"Stubbs (avec un s ) est un nom relativement courant dans les registres d'état-civil de Nantucket (Nantucket Vital Records) de l'époque ; le nom "Stubb", en revanche, n'y figure pas. Le mot stub en anglais signifie "souche", "chicot", "bout" : il peut donc suggérer le caractère direct, brusque et peu subtil du personnage. (P. Jaworski, op. cité, p. 1205).
Le dictionnaire propose aussi pour l'anglais stub le sens de "souche d'un arbre", "talon" (d'un ticket)", "mégot", "bout (de crayon, de chandelle)" ; il rentre dans la composition de pay stub, "fiche de paye". Comme verbe, il signifie "heurter" (son orteil), "écraser un mégot" (he stubbed out the cigarettes in the ashtray).
Flask.
"Le second lieutenant incarne la médiocrité. L'assimilation de Flask à "une fiole vide" au chapitre 134 (p.604) fait référence à la signification du mot anglais flask, "fiasque", "flacon" ". (P. Jaworski, op. cité p. 1205). On peut aussi le traduire par "gourde".
Au chapitre 48, Flask est surnommé little King-post, traduit p. 247 par Jaworski par "le petit plançon" (le plançon est une tige d'osier, de saule ou de peuplier préparée pour servir de bouture), et par Henriette Guex-Rolle par "Le petit Cabrion", le cabrion étant un terme de marine désignant un madrier pour l'arrimage des caisses à eau, ou une pièce de bois servant à raffermir les affûts. King-post désigne à terre une pièce verticale de charpente, élément d'une ferme de toit. Le chapitre 27 nous explique que son surnom illustre son endurance :
"De même que l'on distingue dans les clous de charpentier les clous forgés et les clous découpés, de même l’humanité peut être divisée en deux catégories. Le petit Flask comptait au nombre des clous forgés faits pour river fermement et durer longtemps. A bord du Pequod on le surnommait Plançon,, parce que sa forme pouvait rappeller ces madriers courts et carrés connus des baleiniers de l’Arctique sous ce nom, qui, pourvus d’allonges latérales disposées en rayons, permettent de protéger le navire du heurt des glaces dans ces mers impétueuses." (p. 143)
Les harponneurs:
a). Queequeg (et Yojo).
Queequeg dans le texte original, traduction : "Queequeg" ( Henriette Guex-Rolle), "Quiequeg" (Armel Guerne), "Quiqueg" (Jaworski).
L'article Whence come you, Queequeg? de Geoff Sanborn, paru dans" American Literature " Vol. 77 N°2, Juin 2005 révèle que ce personnage est né après la lecture par Melville de Les Néo-Zélandais (1830), de Georg Lilie Craig, sur le modèle du noble sauvage maori nommé Tupai Cupa. Quiqueg est le fils du roi de l'île de Kokovoko, toponyme inventé par Melville sur des sonorités polynésiennes évoquant entre-autre celles du mot Toi moko.
Les Toi Moko.
Les têtes réduites de guerriers tatoués sont caractéristiques de Nouvelle-Zélande où elle portent le nom de Toi-Moko ou Moko-mokai (alors que le tatouage permanent du visage porte celui de Tā moko, moko signifiant "tatouage". Depuis 25 ans, le pays tente de récupérer quelques unes des têtes répertoriées et dont certaines sont conservées dans des musées. Celle du Muséum d'histoire naturelle de Rouen a été restituée en 2011 ; puis l'ensemble des 20 têtes conservées dans les collections françaises ont été restituées en 2012.
Après leur première découverte de ce rite par le Capitaine Cook, l'intérêt de l'Europe pour ces têtes incita les Maories à en faire commerce, organisant des raids contre leurs ennemis ou capturant des esclaves pour les décapiter et tatouer leur tête post-mortem avant de les faire sécher pour les vendre. Leur commerce a été interdit en Angleterre en 1831. On comprend que Queequeg ait-eu des difficultés à écouler sa lugubre marchandise ("le marché est saturé" (p.38).
Les voyages français d'exploration ramenèrent dans les cales des navires quelques têtes : le Musée de Sens en conservait une ramenée du voyage de Dumont-Durville sur l'Astrolabe de 1827 ; celle du Musée de la Marine avait été rapportée de Nouvelle-Zélande le 5 avril 1824 par René-Primevére Lesson, chirurgien et botaniste de la corvette La Coquille lors de son tour du monde sous le commandement de Duperrey.
Celles des Museum de Rouen et de Nantes et l'une de celles du Muséum National d'Histoire Naturelle ont un intérêt littéraire en rapport avec Gustave Flaubert : Celle du MNHN avait appartenu à Maxime du Camp, l'ami de Flaubert et son compagnon de voyage en Bretagne comme en Orient. Gustave Flaubert rapporte dans Par les champs et par les grèves de 1847 comment il avait découvert au Muséum de Nantes une Toi-Moko, celle donnée en 1826 par le chirurgien de marine François-Louis Busseuil qui l'avait recueillie en Nouvelle-Zélande lors de son tour du monde sur la Thétis de 1824-1826 :
"La belle chose qu’une tête de sauvage ! Je me souviens de deux qui étaient là, noires et luisantes à force d’être boucanées, superbes en couleurs brunes, avec des teintes d’acier et de vieil argent. La première...On a mis prés d'elle une tête d'homme de la Nouvelle-Zélande, sans autre ornement que les tatouages qui l'ont engravée comme des hiéroglyphes et que les soleils que l'on distingue encore sur le cuir brun des joues, sans autre coiffure que ses longs cheveux noirs, débouclés, pendants et qui semblent humides comme des branches de saule. Avec ses plumes vertes sur les tempes, ses longs cils abaissés, ses paupières demi-closes, elle a un air exquis de férocité, de volupté et de langueur. On comprend en la regardant toute la vie du sauvage, ses sensualités de viande crue, ses tendresses enfantines pour sa femme, ses hurlements à la guerre, son amour pour ses armes, ses soubresauts soudains, sa paresse subite et les mélancolies qui le surprennent sur les grèves en regardant la mer."
Quand au Museum d'Histoire Naturelle de Rouen, son rapport à Flaubert est moins direct : ce musée a été dirigé en 1828 à sa création par un chirurgien élève de Cléophas-Achille Flaubert (le père de Flaubert) du nom de Felix -Archimède Pouchet ; le fils de ce dernier, Georges Pouchet (1833-1894) professeur d'anatomie comparée, compte parmi les amis proches de Flaubert. C'est à ce Musée que Flaubert emprunta le perroquet qui est le héros animal de Un cœur simple. Surtout, Felix-Archimède Pouchet avait rassemblé au Museum une collection de moulage de crânes (actuellement conservée au Musée Flaubert et d'Histoire de la médecine) qu'il avait commandé auprès du musée de la Société phrénologique de Paris, inauguré en 1836 et principalement conçu par Pierre-Marie-Alexandre Dumoutier. Une correspondance conservée dans les archives du Muséum atteste d’une première commande de seize têtes et d’un moulage de cerveau auprès de madame Dumoutier. Son mari était alors à bord de l’un des navires commandés par Dumont d’Urville à l’occasion d’une expédition au pôle sud et en Océanie (source : http://criminocorpus.hypotheses.org/4330).
Dumoutier avait été en effet embarqué sur l'Astrolabe comme "préparateur d'anatomie et phrénologiste" sur décision de Dumont-Durville, phrénologue également. (Source : Ackerknecht 1956). On voit le lien étroit qui réunit l'engouement de l'époque pour la phrénologie et la tendance à collectionner des crânes, dont des têtes maories.
L'influence de la phrénologie est perceptible dans Moby-Dick à plusieurs reprises, sous forme directe.
Tout cela ne me donne pas de piste pour comprendre comment Melville a choisi Queequeg come patronyme de son "bon sauvage".
A défaut, j'ai trouvé sur le net :
— cet extrait de la présentation de l'édition Pléiade par Philippe Jaworski : Au chapitre XVIII, Ismaël présente au capitaine Peleg, armateur du Pequod, son ami Quiqueg (Queequeg dans l’original), espérant le faire engager comme harponneur. Peleg, quaker bon teint de Nantucket, ne parvient pas à répéter correctement le nom du sauvage.
Peut-être veut-il éviter d’avoir à prononcer un nom païen, peut-être ne l’a-t-il pas bien compris. Quoi qu’il en soit, il lui substitue un mot vaguement ressemblant, quohog, qui désigne en Nouvelle-Angleterre une grosse palourde, et glisse ensuite à un autre mot proche par le son du premier, hedgehog (« hérisson »). Partant d’une forme francisée du nom polynésien, Quiqueg, nous avons exploité quelques-uns des mots où se retrouve le couple de consonnes c / q ou q / c. Si les repères familiers de l’armateur ont disparu en français, les substituts du nom du sauvage qui viennent maintenant sur ses lèvres révèlent d’autres facettes du personnage : « Allons… dites à votre Qui… Quiconque… Quelconque ? comment l’appelez-vous ?… Dites-ce à ce Quiconque d’approcher. Par la grande ancre, quel harpon il porte ! […] Il nous faut absolument ce Quinconce… je veux dire Quiconque… dans l’une de nos pirogues. »
— Une discussion onomastique sur Queequeg : http://kn0l.wordpress.com/queequeg-le-maori-ou-kuikoe-le-marquisien/
L'auteur, Stéphane Jourdan, pense que le nom Queequeg aurait pu être inspiré à Melville par celui d'une plante parasite qu'il aurait entendu aux Marquises : Kūiko’e, ce qui signifie "celui qui n’a pas de mère". Prononcé par un anglais, cela donnerait quelque chose comme Queequeg. Le nom scientifique de la plante est Decaisnina forsteriana (J.A. Schultes & J. Schultes) et rend hommage au botaniste Johann Reinhold Forster, ou à son fils Georg, qui embarquèrent tout deux sur la Resolution durant le deuxième voyage de Cook de 1772 à 1775. Cette plante est nommée en anglais Red Mistletoe, ("Gui rouge").
Un commentateur a fait remarquer, en faveur de la signification "sans mère" cryptée derrière Queequeg, que le dernier mot du roman, était "orphelin", que la thématique du veuvage et des orphelins était importante dans le récit , et que dans le chapitre 12, la mère de Queequeg n’est pas mentionnée. “His father was a High Chief, a King; his uncle a High Priest; and on the maternal side he boasted aunts who were the wives of unconquerable warriors.”
Melville a séjourné aux Marquises après sa désertion du trois-mâts baleinier « Acushnet », le 8 juillet 1842, à Taiohae, île Nuku-Hiva . Avec un autre marin, il se réfugia dans la vallée de Taipivai où vivaient les tribus Hapaa et Taipi connus pour leur cannibalisme. Le 9 août, il embarquait sur le baleinier Lucy Ann qui l’emmènait à Tahiti. Son séjour forme la base des romans autobiographiques Taïpi et Omoo qui décrivent notamment en détail les conditions de vie des tribus indigènes.
b) Tashtego, "un Indien de race originaire de Gay-Head, le promontoire le plus occidental de Martha's Vineyard, où subsistent les derniers vestiges d'un village de Peaux-Rouges, qui donne depuis longtemps à l'île voisine de Nantucket nombre de ses plus hardis harponneurs" (p. 144).
C'est à Gay-Head (actuellement Aquinnah) qu'est né Amos Smalley (1877-1961), le harponneur qui a tué en 1902 "Moby-Dick", ou, du moins, un cachalot blanc de 90 pieds de long. Gay-Head est l'un des plus anciens site de pêche des cétacés par les indiens Wampanoag, pêche pratiquée alors à partir du rivage puis à l'aide de petites embarcations. Gay-Head est l'une des trois réserves établies au XVIII et XIXe siècle sur Martha's Vineyard, avec Chappaquiddick et Christiantown.
Une compagnie de production de films de New York a pris le nom de Tashtego Films ; Tashtego Punta est le nom d'une pointe en Antarctique.
Je ne peux m'empêcher d'en recopier la description par Melville : on verra comment s'y travaille, sous le signe du Noir, de l'étrangeté et de la pureté, et par le biais du thème de la chasse, celui de l'animalité, laquelle va glisser vers le satanisme :
" les longs et fins cheveux noirs de Tashtego, ses pommettes hautes, ses yeux de jais très ronds,— d'une dimension toute orientale pour un Indien, mais avec des scintillements polaires —, tous ces traits désiganient assez en lui l'héritier de ces fiers chasseurs guerriers au sang pur qui, lancés à la poursuite du grand élan de Nouvelle-Angleterre, avaient battu, l'arc à la main, les forêts primitives du continent. Tashtego, pourtant, ne suivait plus au flair la trace des bêtes des bois, mais le sillage des formidables baleines de l'océan, l'infaillible harpon du fils remplaçant opportunément la flêche impeccable des pères. A voir son corps fauve, souple et musculeux aux lignes serpentines, vous eussiez été tenté d'accorder foi aux superstitions de certains des premiers puritains et de voir dans ce farouche Indien un rejeton du prince des Puissances de l'Air*. Tashtego était l'écuyer de Stubb, le premier lieutenant."
* "c'est-à-dire le diable (Voir Épitre de Paul aux Éphésiens, II,1-2) " (Jaworski, op. cité p. 1205)
c) Daggoo
Traduction : Daggou (Jaworski)
Melville a placé délibéremment ses trois harponneurs sous le signe du sauvage et du paganisme, et on se rappelle que c'est par le sang de ces trois paiëns qu'est baptisé le harpon par lequel Achab va chasser Moby Dick.
Autres :
Perth, le vieux forgeron du Pequod (chapitre 112).
Je ne trouve pas d'autre signification du mot anglais Perth que de renvoyer à des noms de ville, dont en premier lieu la ville australienne, capitale de l'Australie Occidentale ; et je ne voyais là aucun rapport avec le forgeron du bord. Pourtant, la note 2 de la page 540 de Philippe Jaworski m'incite à considérer que Perth, ancienne capitale du royaume d' Écosse, (Peart / Pairt, dérivant d'un mot signifiant "bois") est proche des collines de Birnam et Dunsinane. On se souvient alors de la prophétie faite au roi, dans Macbeth de Shakespeare, "Macbeth jamais ne sera vaincu avant que le grand bois de Birnam n'atteigne la haute colline de Dunsinane et ne marrche contre lui." (Acte IV, scène 1). Outre que l'influence de Shakespeare est considérable sur la composition de Moby-Dick, cette prophétie est clairement reprise par celle faite par Fedallah à Achab : "Le chanvre seul peut te tuer". Le capitaine l'interprète en pensant que seul la condamnation à la pendaison, forcément à terre, peut l'atteindre, et il se considère comme invulnérable face au cachalot. Il occulte la matière dont est faite la ligne de son harpon, en bon chanvre américain.
Faut-il pousser l'érudition jusqu'à étudier la racine grecque πέρθω / pérthô, « détruire, mettre à sac, piller », le radical perth- étant issu de l'indo-européen bher-, « couper » (In étymologie de Persée) ?
Par contre, pour rester dans la mythologie, la fonction du personnage, et sa boiterie, évoquent le dieu Héphaïstos. Il est évident que le portrait du forgeron cache une intention, une cryptographie, et l'hypothèse de la figure d'Héphaïstos, forgeron des flèches d'Apollon et d' Artemis ou de la foudre de Zeus, est assez tentante. Si on a en tête le tableau de Rubens au Prado Héphaïstos forgeant le foudre de Zeus, on lit autrement le passage où Perth forge le harpon d'Achab.
(Source : Wikipédia)

Il y aurait trop à dire sur la dimension mythique du personnage, directement et explicitement lié au mythe prométhéen qui embrase Achab : il faudrait alors analyser phrase après phrase 112 et 113. A celle-ci s'ajoute la dimension saturnienne, ou mélancolique, qui reprend le thème du chapitre 1 : ayant perdu par sa faute (son éthylisme) son travail, son foyer, sa charmante épouse et les têtes blondes de ses enfants, il choisit, plutôt que la Mort, ou, en guise de mort, l'embarquement sur un baleinier :
"mais la mort n'est qu'un départ pour les régions de l'étrange inexploré, le premier salut adressé aux possibilités de l'immense lointain, du monde illimité des eaux. C'est pourquoi aux yeux de ceux qui aspirent à la mort, mais que des scrupules retiennent encore devant le suicide, l'océan qui donne à tous et reçoit chacun — l'océan déploie les séductions de ses vastes plaines aux terreurs inimaginables, fascinantes, et les aventures merveilleuses d'une vie nouvellle. Mille sirène, du cœur de ses Pacifiques infinis, leur adressent leur chants: Viens à nous, cœur brisé ; tu connaîtras une autre vie, libre du péché de la mort qui est passage ; tu connaîtras ici, sans mourir, des prodiges d'un autre monde." (p. 529)
C'est le génie littéraire qui permet, tout en s'inspirant d'un personnage mythologique, tout en suivant une métaphore, d'y fusionner d'autres éléments pour créer un personnage de roman unique. Perth, brûlé, comsumé par le remords ou la honte, erre sur les Océans, mi démiurge, mi-Caïn (hébreu קין qayin, "forger").
Aussi puis-je regretter que la traduction ne rende pas entièrement compte de ce très beau passage où Perth, battant le fer sorti de l'enclume et environné d'étincelles, est interrogé par Achab : "Are-these thy Mother Carey's Childrens, Perth ?". Jaworski traduit, exactement, "Sont-ce là tes pétrels, Perth ? Ils ne quittent jamais ton sillage." On devine que ces pétrels-tempête (storm-petrels) qui suivent fidélement le sillage de Perth (Perth /Petrel) sont ses remords et ses hantises, mais la tradition anglo-saxonne qui les surnomment Mother Carey's Childrens, les enfants de la Mère Carey, dame Blanche féérique qui hante les mers souligne d'avantage que ces pétrels, où les marins voient l'âme des marins noyés, sont ici les enfants décédés de ce Père du Feu volants en incandescences autour de son front.
"Smut".
Ce nom apparaît au chapitre 108 dans la bouche du charpentier : "Come, come, you old Smut, there, bear a hand, and let's have that ferule and buckle-screw" , "Allons, mon bon Noir-de-Fumée, aide-moi...et termine cette virole et cette boucle à vis, je vais en avoir besoin dans un instant." (Jaworski p. 511). Ce surnom est adressé au forgeron Perth, comme le confirme à la page suivante l'échange entre Achab et le charpentier : "Le forgeron, qu'est-il en train de faire ? — Il doit forger la boucle à vis, en ce moment".
Une note de l'édition critique Norton de 2002 précise (p. 358) : "Smut : sailor's name of the blacksmith (from the soot he works in)" : Smut : nom donné par les marins au forgeron ( qui travaille dans la suie)". Le dictionnaire Collins donne deux significations Smut :"charbon", salissant comme la suie, mais aussi : smutty : "sale, indécent, pornographique, obscène". Il provient de l'allemand schmutzen, "salir".
On comprend donc que la traduction "mon bon Noir-de-fumée" laisse peut-être de coté un sous-entendu gentiment injurieux. Henriette Guex-Rolle ne traduit pas et garde le nom Smut.
Pippin, ou Pip,
le mousse, ou "cabin boy", garçon de cabine : son nom est un surnom venant de "pépin", témoignant sans-doute de ce qu'il est noir. Les cabin boy avaient habituellement 14 à 16 ans.
Devenu fou après avoir été abandonné en pleine mer parce qu'il a sauté à deux reprises de la baleinière, il est comme adopté par Achab et installé dans sa cabine. Il joue alors un rôle analogue au "fou du roi", et notamment du fou qui accompagne le roi Lear.
Fedallah :
Le travail a déjà été fait, et il me suffit de recopier la note 1 de la page 247 de la traduction de Jaworski : " Selon Dorothee M. Fonkelstein (Melville's Orienda, New york, Octagon Books, 1971, p. 223-239), le nom Fedallah signifie en arabe " Le Sacrifice [ou la Rançon] de Dieu". Elle précise qu'à l'époque de Melville le terme fedai ("celui qui se dévoue" ou "celui qui sacrifie sa vie" désignait les "anges vengeurs" envoyés par le "vieil Homme de la Montagne" , chef de la secte des Assassins [Hashashin] mentionnée par les Croisés, Marco Polo, Samuel Purchas et autres voyageurs au Moyen-Orient. Fedallah, qui est décrit comme un vieillard, peut être rapproché du chef de cette confrérie secrète musulmane (VIII-XIVe siècle). C'est à l'époque de Melville que le sens du mot "Assassin " et les caractéristiques de cette secte commencèrent à être connus grace aux travaux de l'orientaliste Sylvestre de Sacy (1758-1838). Mansfield et Vincent (Moby-Dick, p. 729-734) mentionnent entre autres sources possibles du nom Fedallah un article anonyme du Specta
tor (n°578 du 9 août 1714 [sic] ) sur le problème de "l'identité personnelle" qui cite abondamment John Locke et résume un conte persan mettant en scène un jeune roi vertueux, Fadlallah ("grâce de Dieu"), victime d'une possession démoniaque. La conception de fedallalh doit sans-doute beaucoup au passage des Confessions d'un mangeur d'opium anglais où de Quincey évoque un personnage qui apparaît mystérieusement sur le seuil d'un cottage anglais, portant un turban et des pantalons flottants ..."etc...
Je voudrais pour ma part souligner que Fedallah est le harponneur d'Achab, et, comme les trois précédents harponneurs, il accumule dans sa description les traits ayant rapport avec la "race" étrangère et ceux se rapportant avec l'inhumanité, l'animalité et du satanisme. Dans ces derniers registres je souligne : entre ses lèvres d'acier saillait maléfiquement, une dent blanche. ...Mais curieusement un turban d'une blancheur éclatante couronnait cet ébène : sa crinière, tréssée et enroulée plusieurs fois sur sa tête. D'une complexion moins bistrée, ses compagnons de cet individu avaient le teint vif, jaune roux du tigre particulier aux indigènes de Manille, une race célèbre pour la subtilité diabolique de ses ressourceset que certains honnêtes marins blancs jugent composée des espions à gage et des agents secrets du diable sur l'eau...Paré, Fedallah? Paré, lui fut-il répondu dans un sifflement.
Fleece :
C'est le cuisinier noir, vieux et boiteux du bord.
Traduction "Laine-de-mouton" (Jaworski), "Toison" (Henriette Guex-Rolle) : c'est l'un des noms de personnage les plus fascinants du roman. Le mot anglais fleece signifie :
— nom : fleece : "toison" Sheep's fleece, "toison d'un mouton", donc" peau de mouton, laine de mouton", et par extension moderne pour un vêtement isolant du froid, "molleton", "polaire". Dans l'expression the Golden Fleece, le terme désigne la Toison d'or que Jason et les Argonautes partent conquérir en Colchide.
— verbe : to fleece "tondre", "tondre la laine sur le dos de", "plumer, voler, escroquer".
Une fois de plus (mais tout l'art onomastique est là), la polysémie du mot permet à Melville de jouer avec notre imagination : nous pourrons y voir une allusion aux cheveux crépus mais blancs du vieil homme, ou bien au contraire un sobriquet qualifiant par son contraire la couleur du" vieil ébène" (p.331), ou un lien entre la croisière du Pequod et la quête de cette Toison d'Or qu'est le cachalot blanc, ou y entendre à demi-mots une dénonciation de la façon dont les Blancs ont tondu, continuent à plumer les Indiens et les Noirs. Cette dernière interprétation se fera d'autant plus forte lque le cuisiner sera surtout en scène au chapitre 64, "Le Souper de Stubb". Dans cette scène, on voit l'officier se faire préparer un steack de baleine, à minuit, puis reprocher cruellement au cuisinier la cuisson excessive de la viande, et le contraindre, comme par brimade, à aller s'adresser aux requins qui dévorent la carcasse de la baleine avec la même avidité sanguinaire que celle de Stubb. C'est la proximité de ces requins, ces milliers de requins qui, "se vautrant", "se goinfrant goulûment", trouble le repas de Stubb par le claquement de leurs machoires ; et c'est la proximité de leur cruelle voracité avec celle des hommes qui fait écrire à Melville, après qu'il ait décrit les requins attirés par victimes des combats navals, ou par les esclaves nègres que les négriers jettent par dessus bord, " la chose n'en demeurerait pas moins ce qu'elle est —une sinistre et requineuse affaire, à queque bord qu'on appartienne".(p. 329)
Fleece — appellons le Laine-de-mouton —, sur l'ordre de Stubb, se penche donc sur le bastinguage pour adresser aux squales ce morceau d'anthologie qu'est son Sermon aux requins. Depuis ses premières pages, Melville a souligné de traits animaux ses portraits d'Indiens, de Noirs et des hommes d'équipage : il va montrer ici combien Laine-de-mouton, que nous voyions dans le regard de Stubb comme un être primitif ou demeuré, se révèle capable de communiquer avec les animaux. Et la parole de Laine-de-mouton, ce sabir qu'il est difficile de transcrire autrement qu'en reprenant les stéréotypes "petit-nègres" du colonialisme, va se révéler une Langue des oiseaux superbement cocasse et poétique et suprêmement sage.
L'officier blanc (et sans-doute avec lui tout un pan de la société américaine, un large pan de la socièté européenne, une trés large partie de l'esprit de conquête de de domination, et, soyons généreux, tout l'ensemble de l'esprit de lucre de l'humanité) va se confondre avec les requins, et, en face de lui, Laine-de-mouton, dans sa sage innocence bafouée et humiliée, va se dresser comme une force animale d'une autre nature, intuitive, saine, mesurée et bon-enfant ; Stubb n'entendra pas ce Sermon aux requins qui s'adressait à lui, continuera à persécuter Laine-de-mouton, mais celui-ci aura, in petto, le dernier mot : "J'veux bien être pendu s'il n'est pas plus requin qu' Maître Requin lui-même!".
La traduction française ajoute encore un grain de drôlerie à cette "requinade" et à cette "moutonnade" en qualifiant le cuisinier de "coq".
Dough-Boy :
traduction Boulette-de-farine (Jaworski) ; Dough signifie "pâte", (dough-nut : "beignet", transposé en donut comme chaque émule d'Homer Simpson le sait). On pouvait aussi traduire par Bonne-Pâte.
Armel Guerne a traduit par "Mie-de-pain" ; Henriette Guex-Rolle par "Pâte-Molle".
C'est le maître d'hôtel (the steward), dont la pâleur est plusieurs fois soulignée : cette pâleur peut expliquer son surnom.
Archy :
homme d'équipage qui apparaît page 223.
Cabaco,
homme d'équipage qui dialogue avec Archy à la même page 223 ; c'est un Cholo, metis d'espagnol et d'Indien péruvien.
Les Instructions pour remonter la côte du Bresil pour la Côte méridionale du Brésil et le Rio de la Plata par Charles Philippe de Kerhalet (1841) décrivaient, de la Pointe nord de Sainte-Catherine au cap Santa-Marta-Grande, le Cap Quebra Cabaço ; Cabaços est aussi un toponyme portuguais (Ponte de Lima) ; et le mot cabaço signifie, en portuguais, "pucelage".
Bulkington
...devait être, dans un premier projet le compagnon de couchette d'Ismaël ; son sleeping-partner, qui partagera son lit. Aucune ambiguïté ici, mais il faut connaître le système des bordées, que nous présente Édouard Corbière dans Conte de Bord (1833):
"Pour former ces bordées, on divise l'équipage en deux parties égales. Chaque partie de l'équipage, commandée par un officier et un maître, prend le quart à son tour, pendant que l'autre moitié dort ou se repose dans les cabanes ou les hamacs. La première bordée se nomme la bordée de tribord, et par dérivation, on désigne les marins qui la composent sous le nom de Tribordais. L'autre bordée est celle de babord, et elle se compose de Babordais. Uns cabane ou un hamac sert à deux hommes dont l'un est tribordais et l'autre babordais. Les deux hommes dont le hamac ets commun sont matelots l'un à l'autre ; aussi chacun d'eux appelle-t-il son camarade son matelot.[...] Presque toujours il arrive que les deux marins qui se conviennent assez pour désirer être amatelotés ensemble mettent en commun tout ce qui peut contribuer à solidariser les petites jouissances qu'ils peuvent se procurer à bord. La provision d'eau-de-vie se partage entre eux : le tabac qui doit servir dans la traversée est fumé ou chiqué en commun, et il est fort rare que le partage parfois inégal des objets mis en consommation pour l'usage des deux parties fasse naître entre les deux interessés d'égoïstes contestations. La paix et l'union règne presque constamment dans ces sortes de ménage d'hommes, d'où la passion et à coup sûr la jalousie sont exclues par la nature même de cette alliance toute fraternelle".
Supplanté par Queequeg, on le retrouve encore, tel un fossile de l'ère primaire de rédaction, dans le chapitre 23 qui lui est consacré en guise de stèle funéraire, puisqu'il ne réapparaîtra plus. Encore les pages qui sont consacrées à cet alter ego du narrateur ne laissent-elles pas d'intriguer. Selon la note 1 de la page 36 de la traduction de P. Jaworski, qui cite Harrison Hayford, il est "un doublon inutile" que Melville n'a pas eu le souhaît et le temps d'effacer. Mais cela n'explique pas ses caractéristiques mystérieuses.
La première de celle-ci est qu'aussitôt débarqué d'une campagne de quatre ans sur l'Épaulard, il s'embarque sur le Pequod : la terre semblait lui brûler les pieds. Cette fuite vers l'Océan laisse suspecter que, coupable de quelque crime, il regagne au plus vite le No-man's-land maritime.
L'autre caractéristique est là dés la première phrase qui le présente : Je remarquai que l'un d'eux, pourtant, se tenait un peu à l'écart. Si bien à l'écart qu'il est discret jusqu'à l'effacement pour ce qui concerne cette histoire (p. 35), avant de s'éclipser subrepticement, et je ne le revis plus jusqu'au moment où, en mer, il devint mon camarade. Si, populaire parmi les marins de son bord, il est remarquable, c'est par son absence (p.36) qui les amènent à l'appeller Bulkington ! Bulkington ! Où est Bulkington ?
Enfin, tout le chapitre La terre sous le vent qui lui est consacré reste difficile à déchiffrer. Ce serait "une stèle" sans épitaphe, car les plus profondes images de la mémoire jamais ne donnent lieu à des épitaphes ; une "tombe sans pierre". On pense que ce personnage va bientôt disparaître en mer, ce que confirmerait la dernière phrase Farouche soit ton combat, demi-dieu ! De l'écume soulevée par ta mort océane jaillit, verticale, ton apothéose ! Mais on perçoit bien que le sens est ailleurs, métaphorique et poétique, comme si l'éloge funèbre s'adressait à une part sauvage et ombrageuse du narrateur ou de l'auteur, jalouse de son indépendance, une part altière mais suicidaire fuyant la terre et ses compromissions, le confort et la sécurité, une part sacrificielle par laquelle Melville annonce tous ses refus de compromissions éditoriales et le naufrage en haute mer de sa carrière.
J'ai idée que ce Bulkington que la terre insupporte, avce ces "écarts", ses absences, le caractère subreptice de ses éclipses, ne serait pas étranger à cette part de l'âme de Melville —la compagne de ses nuits, sa sleeping-partner — qui se concrétisera quatre ans plus tard en Bartleby.
Bulkington est, avant d'être ce patronyme, un toponyme anglais, construit comme tel avec le suffixe -gton (ou -ton, -ghton) venant du vieil anglais -tun, hameau ( Claughton, Washington, Laughton, Houghton).
Peter Coffin
est le propriétaire de l'auberge Au souffle de la baleine à New Bedford. Le mot signifiant "coufin", "cercueil", et cela permet au narrateur d'y voir un mauvais présage. Ce patronyme appartient, avec Gardner et Starbuck aux plus anciens noms de famille de baleiniers de Nantucket : Tristram Coffin, qui était né à Plymouth en 1609, émigra en Amérique en 1642 et s'établit à Nantucket ; la famille se mit à la pêche à la baleine dès 1690, et possédait trois baleiniers en 1715; En 1763, on dénombre six capitaines de la famille naviguant sur les mers du globe du Groënland jusqu'en Amérique du Sud. En 1823, c'est à Java qu'un James Coffin s'illustre puis dans le Pacifique en découvrant une des îles du groupe Phoenix ; son collègue Joshua Coffin, inévitablement capitaine d'un baleinier, en découvrit une autre qu'il baptisa Île Gardner. J'ignore quel capitaine Gardner ou Starbuck lui rendit la pareille, mais deux îles portent le nom d'île Coffin, au confin du Canada (Nuvanut) et à l'Ouest de l'Australie. Un 1823, Reuben Coffin baptisa l'une des îles Bonin (au sud du Japon) du nom de la famille. Mais il serait vain de vouloir citer tous les Captain Coffin, tous leurs haut-faits, et aucun quai du monde ne serait assez long pour accueillir les centaines de milliers, le million peut-être de barils de sperm oil, de spermaceti. Pourtant, il faut mentionner, pour mieux imaginer les souffrances du capitaine Achab ce capitaine Coffin qui, grièvement blessé à la jambe lors d'une chasse à la baleine, ordonna à son second de lui couper la jambe avec un couteau, menaçant de le tuer s'il n'obeissait pas et braquant son arme sur lui pendant toute l'opération. Source Coffin (whaling family), Wikipédia.
The Spouter-Inn.
Précédée par le nom de trois autres établissements (The Crossed Harpoons, The Sword-Fish Inn et The Trap, "Les Harpons Croisés", "L'Auberge de l'Espadon" et "Le Guet-Apens"), l'auberge The Spouter-Inn (traduit par "Au souffle de la baleine") amène à rechercher dans le dictionnaire le sens du mot Spouter : outre le sens du verbe (To gush forth in a rapid stream or in spurts / To discharge a liquid or other substance continuously or in spurts.), on donne, (The Free Dictionary) pour le nom, les sens suivants
-
1. A tube, mouth, or pipe through which liquid is released or discharged.
2. A continuous stream of liquid.
3. The burst of spray from the blowhole of a whale.
4. Chiefly British A pawnshop (mont-de-piété).
On peut suspecter Melville de jouer sur la polysemie du mot, qui n'est pas sans arrière-fond. Henriette Guex-Rolle ayant traduit avec audace par "Auberge du Souffleur Peter Coffin", je relis l'original. Effectivement, le nom de l'auberge est " The Spouter-Inn—Peter Coffin". Il sera abrégé au chapitre 3 en The Spouter-Inn, l'Auberge du Souffleur (H. G-R), ou Au souffle de la baleine (P.J)
- Mme.Hussey est la femme d'Osée Hussey, propriétaire de l'auberge le Tâtes-pots à Nantucket.
-
Osée Hussey est le cousin de Peter Coffin et le propriétaire de l'auberge le Tâtes-pots à Nantucket, il n'est que mentionné. Mais il porte le prénom d'un prophète de la Bible
Le mythe de l'Amérique : http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ahess_0395-2649_1970_num_25_6_422299
II. Melville et l'humour.
(PROJET)
Philippe Jaworski op. cité: "Moby-Dick est, avec Huckleberry Finn, le plus grand roman comique américain du XIXe siècle" (p. 1167) "Des passages de pure comédie viennent souvent faire contrepoint à la tragédie d’Achab. Moby-Dick est, avec les Aventures de Huckleberry Finn (1884) de Mark Twain, le plus grand roman comique américain du XIXe siècle. Cette dimension du livre a pourtant été souvent négligée par les traducteurs précédents. Melville exploite à peu près toutes les formes du genre, de l’humour le plus fin à la farce la plus facile – comme Rabelais dont il était un lecteur gourmand. Melville peut même être joyeusement grivois voire obscène."
N.B : Il me faudra étudier l'influence, évidente, de Laurence Sterne et de Swift.
Diverses formes d'humour sont utilisées par Melville, mais je n'ai pas fréquenté les enseignements universitaires où de dignes Professeurs qui, comme Robert Provine (Maryland) ont fait progresser l'humanité dans son exploration de la Terra Incognita des mécanismes du rire : en la matière, je suis resté sur le gaillard d'avant, utilisant mes muscles (zygomatiques) plus que mes neurones.
Ainsi, lorsque Melville écrit dans son chapitre sur la couleur blanche que "la prééminence de la blancheur s'applique aussi à la race humaine, puisqu'elle consacre l'autorité suprême de l'homme blanc sur toutes les tribus basanées", il ne place aucun smiley explicite [ a parte : s'il est bien quelque-chose à classer parmi les tue-l'humour, c'est bien le smiley]. Aucun trait de son visage, aucun clignement de l'œil, aucune intonation amusée ne vient aider notre regard interrogateur qui, tel l'enfant face au grand-père facétieux, tente de deviner si c'est du lard ou du cachalot. L'auteur reste de marbre blanc ; faut-il rire jaune ?
En fait, le vénérable Pr. R. Provine a constaté sur des milliers d'observations que ce qui nous faisait rire, ce qui déclenchait ce "reliquat vocalistique proche du cri ancestral" n'était absolument pas drôle en soi : pour rire, il faut appartenir au groupe qui rit, par mimétisme ou "pour lubrifier les relations".
Sommes-nous encore, avec l'humour, dans le rire? Le rire de l'humour n'est-il pas, toujours, jaune ?
Voici un trait d'humour du livre : " Why such a whale became thus marked was not altogether and originally owing to his bodily peculiarities as distinguished from other whales; for however peculiar in that respect any chance whale may be, they soon put an end to his peculiarities by killing him, and boiling him down into a peculiarly valuable oil. " Le rire naît de la répétition du mot, que je souligne. Jaworski traduit ainsi : "Qu'on ait pu en venir à distinguer ainsi un individu ne s'explique pas seulement, à l'origine, par ceux de ses traits physiques qui le différencient de ses congénères, car si singulier que soit l'aspect d'une baleine rencontrée par hasard, ses chasseurs ne tardent pas à réduire ses particularités à néant en tuant l'animal et en le faisant bouillir pour en extraire une huile particulièrement précieuse."
C'est ici plutôt un jeu qu'un rire, un jeu de mots qui fait grincer ironiquement la bascule par laquelle la différence, l'individuation d'un animal doté d'un nom propre s'inverse dans son contraire, l'odieuse indifférentiation en un produit économiquement estimable. Ce renversement en son contraire n'est drôle que par dépit, ou par défense.
La survenue de ces traits d'humour mériterait d'être étudiée. Ils sont parfois émis en salves, dans des chapitres guillerets où l'auteur s'est assis devant son pupitre de belle humeur, et bien décidé à s'amuser, comme dans les premiers chapitres, ou dans ceux qui se consacrent à la cétologie (55 à 57) en mimant et minant le ton doctrinal. Mais les blagues "bréchent" parfois aussi, rompant la surface d'un récit lisse et disparaissant avant même que le lecteur ait réalisé qu'il y avait là matière à une bonne pêche. Ainsi au chapitre 53, La Game, Melville décrit les rencontres entre navires baleiniers en pleine mer, tradition qu'ignorent les autres navires, négriers trop pressés, navire marchand trop indifférents, navires de guerre trop protocolaires, et pirates qui méprisent les "bouilleurs de graisse" et les regardent de haut. C'est une écriture au long cours, portée par la houle d'un style régulier, et puis soudain, à propos de ces pirates hautains : "Leur carrière peut s'achever sur une position exceptionnellement élevée, mais seulement à la corde d'une potence. En outre, celui qui touche à de si inhabituelles hauteurs ne saurait se prévaloir d'aucun véritable fondement. D'où je conclue que lorsque le pirate se flatte d'être supérieur au baleinier, il ne s'appuie sur rien de solide".
Les chapitres 89 et 90 appartiennent à la grande tradition satirique. Le premier, en nous expliquant les régles par lesquelles les baleiniers affirment leurs droits sur leur prise ("un poisson amarré appartient à celui qui l'a amarré ; un poisson perdu est au premier qui l'attrape"), généralise ces régles comme réglant nos sociétés par le Droit du plus fort et donne l'occasion à Melville d'illustrer cette loi par de nombreux abus de pouvoir de l'Angleterre et de sa noblesse. L'autre, encore plus acerbe, se termine par cette phrase impeccable : "Il semblerait qu'il y ait une raison à tout, même aux lois" (And thus there seems a reason in all things, even in laws). Chute cynique de tout le chapitre, concise et laconique, au superbe conditionnel, et à la malignité délicieuse de l'inversion finale, même aux lois.
III. Par çi par là.
1. Les deux prédations.
Constatant comme chacun que Melville dénonçait, toujours entre les lignes, une civilisation d'asservissement, jusqu'à l'extinction, du Vivant et de l'Autre (dont les cétacés et les Indiens étaient les emblèmes), société policée puritaine esclavagiste et son christianisme de façade masquant les appétits de puissance et de possession de la colonisation, j'ai d'abord cru qu'il opposerait à cette attitude prédatrice délétère des valeurs opposées proche du Transcendentalisme, pacifique, "fleur bleue", édenique, végétarienne et contemplatrice. Il n'en n'est rien.
A la prédation calculée du capitalisme ou de l'impérialisme, basée sur la domination de l'homme sur ce qu'il considère comme différent et inférieur à lui, Melville oppose la prédation sauvage de la chasse, violente, passionnelle, païenne mais basée sur le mimétisme, la capacité de vaincre l'autre à force d'en être devenu son alter ego.
Achab, capitaine d'une usine quasi industrielle de production d'huile de baleine et de produits dérivés, bascule dans la seconde prédation, transforme son navire en l'équipant de dents de cachalots, constituant un équipage de chasseurs primitifs, et, déjà muté par sa prothèse de jambe en ivoire de cachalot, poursuit sa lente métamorphose jusqu'au combat final.
Que le christianisme, ou sa caricature puritaine ou quaker, soit opposé au satanisme qui accompagne systématiquement l'animalité des chasseurs, ne signifie pas que nous ayons affaire à une lutte du Bien contre le Mal, de Dieu contre le Diable: deux volontés de puissance se développent, parallélement, sous des couleurs empruntées qui les théâtralisent. Elles ne s'opposent pas entre elles, mais toutes les deux répondent par le déploiement de leurs forces à un seul et même adversaire, la Mélancolie, celle-là même qui pousse Ismaël à s'embarquer.
2. Les deux narrateurs.
Lorsqu'on débute le roman de Melville par la phrase "Appelez-moi Ismaël", on pense que le narrateur qui s'exprime à la première personne est bien défini ; ma is lorsque le Pequod a pris la mer et que le "je" narratif s'efface pour une description neutre, ou que les phrases prononcées à voix basse par Achab, et donc difficilement perceptible pour un homme du gaillard d'avant comme Ismaël ("On a l'impression de descendre dans sa tombe", se murmurait-il à lui-même (p. 151), on réalise qu'Ismaël a abandonné le pupitre de la narration au profit d'un omniscient, et que le point de vue narratif s'est modifié. On en trouve confirmation lorsqu'au chapitre 44 dans la cabine d'Achab, ce saint-des-saints où nous avons le privilège inouï de jeter un coup d'œil au dessus de l'épaule du capitaine pour le voir tracer sa route sur la carte. Mais cette duplicité devient franchement manifeste au chapitre 42, La Blancheur du Cachalot, lorsqu'on surprend le narrateur parler (p.224) d'Ismaël comme d'un personnage exterieur. Les soutes du Pequod abritent des passagers clandestins ; de même le roman a-t-il embarqué, à notre insu, un -voire plusieurs-narrateurs clandestins.
3. Les quatre niveaux d'écriture.
Les Écritures peuvent s'interpréter de quatre façon en herméneutique juive [Docrtine des quatre sens Peshat (litteral), Remez (allusif), Drash (littéralement :"sonder" :allégorique), Sod (secret, mystique)], ou selon l'enseignement d'Origène et des Pères de l'Église [historique, allégorique, tropologique, et anagogique]. Quels mots savants faut-il créer pour décrire comment l'écriture de Melville peut décrocher brutalement d'un "sens" à l'autre, ou bien faire courir un double sens que l'on devine sans qu'il ne fasse clairement surface ?
L'écriture de base est celle du récit : c'est l'écriture officielle d'un roman d'aventure maritime.
La seconde, je l'ai dit, est très vite apparente, c'est celle du récit franchement comique, type Three men in a Pequod, ou de l'humour complexe.
La troisième est celle de la tragédie.
La quatrième est celle de la métaphore philosophique. Comme pour l'humour, elle se révèle sans crier gare, amenant le lecteur à se demander soudain si elle ne le suivait pas entre les lignes depuis un bon moment. Il croyait lire (chap. 68) la description de la couenne des cétacés (description, Melville s'en est plaint, peu encline aux envols poétiques), et voilà que l'épaisse isolation qui permet à l'animal de fréquenter les milieux thermiquement hostiles sert de prétexte à vanter "la rare vertu d'une forte vitalité individuelle, la rare vertu de murs épais et d'un vaste espace intime". L'aimable Cicerone plaisantin qui guidait les touristes du Marinaland ou du "Parc Moby-Dick" s'est transformé en Assurancetourix coiffé de laurier qui brandit sa lyre et, les yeux levés au Cieux, entonne cette exortation : "Homme ! Admire et imite la baleine ! Comme elle, préserve ta chaleur parmi les glaces ! Comme elle, sache vivre dans ce monde et n'appartenir qu'à toi-même !" Etc..., puis "Combien peu d'hommes peuvent prétendre à la vastitude de la baleine ! "

Étrange appel décrivant l'être humain comme devant affronter l'hostilité de ses semblables, dans une conception romantique de l'Artiste. Cela vole très haut, il aurait fallu nous prévenir, nous aurions emmené une petite laine... mais un cri survient "Embraque les chaînes ! Largue la carcasse !" (p. 344), le récit nous ramène au zéro des cartes, derrière les Davy Crocket des mers du Sud, nous avons encore prés de 300 pages à parcourir vent arrière, trop tard pour rêver sur ce qui, derrière nous, s'est inscrit dans le sillage.
4. Quiqueg en kilt : de qui se moque-t-on ?
Si mes amis, qui me connaissent comme une personne policée et de mœurs empreintes de dignité, m'apercevaient soudain amorçant un truffle shuffle ou mangeant un goulbiboulga avec Casimir, ils ne seraient pas plus étonné que je le fus lorsque, parvenu au chapitre 72 de ma lecture de Moby-Dick, je lus la phrase suivante : "Quiqueg, à cette occasion, portait le costume écossais, kilt et chaussures montantes — dans lequel il était, à mes yeux du moins, tout à son avantage" (op. cité, p. 355) Le costume écossais ? Kilt et chaussures montantes ? Pour un harponneur maori tatoué sur tout le corps, qui se rase avec son harpon, fume le tomahawk, et qui ne possède dans toute sa lignée d'ancêtre aucun écossais, mais d'authentiques cannibales ? Kilt et chaussures montantes au moment où, envoyé sur le dos du cachalot amarré au flanc du Pequod pendant son dépècement, il tente de maintenir son équilibre en un rodéo périlleux, à demi-submergé par les vagues ?
Dans les cas difficiles, il convient de retrouver le texte original : voyons : " On the occasion in question, Queequed figured in the Highland costume — a shirk and socks — in which, to my eyes at least, he appeared to incommon advantages ; and on one had a better chance to observe him, as we presently be seen."
Il s'agit de l'édition critique de H. Hayford, H. Parker et G. T. Tanselle, Norhwestern University Press & The Newberry Library, 1988, vol. 6. Cette édition commente en note le mot [shirk] : "NN emends the A and E reads "shirt" as a misreading for "skirt", since not a shirt but a skirt and sockes are the two articles of Scottish dress corresponds to "tartans" (i.e the kilt) and "leggins" in Melville description of the ship Highlander's painted figurehead with "bright tartans, bare knees, barred leggins and blue bonnet" in chapter 24 of Redburn. Whereas a skirt is a lower garment, a shirt is always an upper one (whether inner or outer, short or long). For more secure foothold, harponners customary stoods on the whale slippery back shoeless but in woolen sockes. To conserve their usual clothes during this wet and bloody job, they often donned old articles of dress, such as old trousers. While the idiom "in one's shirt" or "in one shirttails" may means "with one's pants off", it is unclear here what item of Queequeg's dress (or undress) — surely neither a short nor long short — would ressemble a skirt, but perhaps in effect a short wraparound "butcher's apron" leaving his bare knees visible. In any case, the way Queequeg appeared is suggested by a citation of Scott's Waverlay in the Oxford English Dictionary, sv "kilt" :the short kilt, or petticoat, showed his sinewy and clean-made limbs".
Ce que je comprends de cette note est que les exégètes américains ne s'étonnent pas de voir Quiqueg danser sur la baleine en kilt, ou en "tablier de boucher" quoiqu'ils signalent que l'expression "in one's shirt" signifie "nu, sans pantalon".
Henriette Guex-Rolle reste assez prudente dans sa traduction, mais, à la lire, on comprend clairement que Quiqueg, s'il porte une chemise et des chausettes, est, par ailleurs, parfaitement nu : "En l'occurence, Queequeg s’y trouvait vêtu à l’écossaise – en chemise et chaussettes – tenue qui, à mes yeux du moins, le faisait paraître particulièrement à son avantage, et personne plus que moi, on va le voir, n’était mieux placé pour l’observer."
Armel Guerne traduit de la même façon : " Cette fois-ci donc, Quiequeg s'y tenait, vêtu à l'écossaise — c'est-à-dire en pans de chemise et en chaussettes— costume qui, à mes yeux, lui seyait à ravir."
D'ailleurs, Quiqueg a bien voulu prendre la pose en tenue écossaise pour le site classicrants : je découvre plus tard que cette image fait partie d'une lecture critique de Moby-Dick sur un site Ambrmerlinus.livejournal qui propose de nombreuses illustrations aussi réussies que celle-ci par un artiste signiant KVH: cette découverte sera la plus belle gratification de mes recherches.

Une autre édition critique des mêmes auteurs H. Hayford, H. Parker donne la note suivante en 2002:
"Not an actual Scottish kilt but a something like a butcher’s skirtlke apron, no pants, and (for traction) coarse socks and no shoes. “Skirt” is [a Northwestern-Newberry edition] emendation for “shirt”; Melville was recalling a passage in Sir Walter Scott’s Waverly (1814) on a kilt’s showing off a mian’s sinewy limbs, with the additional joke that in his rolling and swaying on the whale and in Ishmael’s jerking him with the rope Queequeg shows off more than his legs to the appreciative Ishmael."
En conclusion, selon nos dernières informations (supra, 2002), Quiqueg était nu sur son cachalot, mis à part une chemise et une paire de chaussettes, se livrant à des acrobaties pour maintenir son équilibre, et on comprend qu'aux yeux d' Ismaël, qu'il n'est plus désormais possible de ne pas qualifier d'amant de son bel harponneur, il soit "tout à son avantage". Déjà nous avions lu, au chapitre IV, les phrases "En m’éveillant, au point du jour, le lendemain matin, je constatai que le bras de Queequeg m’entourait de la manière la plus tendre et la plus affectueuse. On aurait presque pu croire que j’étais sa femme. [...]; seule la sensation de poids et de pression me laissa deviner que Queequeg me tenait enlacé." (Trad H.G.R) Déjà le chapitre 10 se concluait sur ces phrases explicites : "Il n’y a pas de lieu plus favorable qu’un lit aux révélations confidentielles entre amis, je ne sais pourquoi. On dit que mari et femme s’y dévoilent l’un à l’autre le tréfonds de leur âme et il est des vieux couples qui, étendus, y parlent presque jusqu’au matin du bon vieux temps. Ainsi dans la lune de miel de nos cœurs, étais-je allongé auprès de Queequeg. Couple envahi de bien-être et de tendresse." (H.G.R).
Mais nous laissions flotter l'ambiguïté.
Ce chapitre 72 nous présente donc Quiqueg sur sa baleine, ceinturé à la taille par un baudrier attaché à une sangle qu'Ismaël, du bord du navire, manie pour prévenir une chute malheureuse parmi les requins. Melville, pris de scrupule, précise que cette "laisse à singe" (The Monkey-Rope) n'est pas utilisé ainsi chez les baleiniers : autrement dit, elle est inventée ici par la seule, mais impérieuse nécessité de parfaite l'image géméllaire du couple des amants ; la "laisse à singe" n'est pas là pour se moquer de Quiqueg, même si Melville n'hésite pas à forcer le trait : "Vous avez assurément déjà vu ces jeunes italiens avec leur orgue de Barbarie et un petit singe qui fait des cabrioles au bout d'une longue laisse. De semblable manière, je tenais Quiqueg, du flanc abrupt du navire, au bout de ce que les pêcheurs appellent familièrement "une laisse à singe", attachée à une forte bande qui lui enserrait la taille". Non, elle est là pour mettre de l'animalité dans la scène.
La phrase suivante va plus loin encore dans l'image du couple uni pour le meilleur et pour le pire : "Car, avant d'aller plus loin, il faut dire que cette laisse était assujétie aux deux extrémités —à la large ceinture de toile de Quiqueg et au cuir étroit à la mienne. Ainsi, nous étions, provisoirement unis pour le meilleur et pour le pire ; et Quiqueg dût-il couler pour ne plus jamais remonter, l'usage et l'honneur voulaient que, loin de couper la corde, je me laissasse entraîner à sa suite. Un long lien siamois nous attachaît donc l'un à l'autre. Quiqueg était mon inséparable jumeau, et il m'était rigoureusement impossible de faire fi des dangereuses responsabilités que comportait cette ligature de chanvre" (P. Jaworski, p. 356)
Viennent alors des considérations "métaphysiques" sur l'interdépendance des êtres humains entre eux, considérations qui tempèrent, voire contredisent celles que le narrateur développaient à propos de la nécessité de s'isoler au mieux des autres comme le cachalot s'isole du froid.
5. Achab, une figure de Jacob luttant contre l'Ange.
Le chapitre 106, La jambe d'Achab, est plein de mystère. Pour introduire les scènes pendant lesquelles le charpentier et le forgeron referont une nouvelle prothèse tibiale (nous savons que l'amputation s'est faite sous le genou) et sa virole, et pour justifier la necessité de cette nouvelle prothèse en ivoire de cachalot, il ne suffit pas à Melville de raconter qu'en quittant, de méchante humeur le Samuel Enderby, Achab a atterri si violemment dans sa baleinière que sa jambe de bois animal s'est "à demi-fendu" ; et que, plus tard, son pilon calé sur le trou de tarière, se retournant avec véhémence, il avait aggravé les choses. Non, négligeant ce prétexte au renouvellement d'appareillage qu'il vient de bâtir, Melville le réduit à néant en écrivant : certes, la jambe demeurait entière et gardait toutes les apparences de la solidité, mais Achab ne la jugea plus tout à fait digne de confiance. La violence de son comportement autoagressif (contre sa jambe) et heteroagressif (contre le cachalot dont l'ivoire provient) a créer une faille, mais qui reste interne, félure de la confiance en soi du capitaine.
C'est alors que Melville raconte (p. 506) une histoire si invraisemblable, si manifestement cousue de toute pièce pour placer un emblème (qui s'avérera inutile sur le plan narratif et ne sera pas exploité autrement que par ce qu'il nomme allegoricalness) qu'il se justifie en permanence : "par un mystérieux accident, apparemment inexplicable et difficilement imaginable" , peu avant que le navire ne quitte Nantucket, "on l'avait trouvé une nuit gisant de tout son long sur le sol, sans connaissance.". "la jambe d'ivoire avait été si violemment déplacée que, tel un épieu, elle avait frappé l'aine, et même failli la transpercer ; et ce n'est qu'au prix d'extrèmes difficultés que la suppliciante blessure put être entièrement guérie". Pendant cette période précédant l'appareillage (du Pequod...) Achab "s'était tenu caché, menant une vie de réclusion digne du Grand Lama, et durant cet intervalle cherchant un muet refuge auprès du sénat marmoréen des morts".
L'aine est réellement le dernier endroit qu'une jambe de bois, fut-elle en ivoire, peut venir atteindre sur le corps de son propriétaire. Cette blessure n'est, à l'évidence, que symbolique, occasion pour Melville/Achab d'un monologue sur cette souffrance, "suite directe d'un malheur plus ancien", "certaines coupables misères humaines procré[ant] pour l'éternité une race fertile de douleurs par delà la tombe", souffrance hissé au statut de Douleur de l'âme à la "signification mystique" et, chez certains, à la "grandeur archangélique".
Je connais au moins trois blessures de l'aine célèbres :
1. Le Père méhaigné : Perceval le Gallois de Chrétien de Troye
Comme la blessure du pied était une transmission trans-générationnelle dans la famille d'Oedipe (littéralement "pied gonflé) par Laïos "le gauche" et Labdacos-le-boiteux, la blessure invalidante des jambes est récurrente dans la famille de Perceval, atteignant son père « votre père, si vous ne le savez, fut blessé cruellement aux jambes dans un combat. Il n’eut plus la force de défendre ses grandes terres » p.42, et son cousin le roi Pêcheur « en bataille fut blessé et mehaigné si tristement qu’il perdit l’usage des jambes. On dit que c’est un coup de javelot porté aux hanches qui lui a fait cette blessure » p. 96. Cette fatalité familiale entraine la stérilisation du patrimoine, les "terres gastes". L'aine, ici, désigne par métonymie la fécondité.
N.B : je constate qu'un auteur, Marie Blaise, a déjà souligné cette analogie : Job, Achab et le Roi-pêcheur.
2. Jacob luttant contre Dieu : La Genèse 32,23-28.
C'est le fameux épisode du gué de Peniel où Jacob lutte toute la nuit contre un homme , qui ne parvient finalement à le vaincre qu'en lui portant un coup à l'articulation de la hanche, avant de lui révéler : "Désormais, reprit l'autre, tu ne t'appelleras plus Jacob mais Israël (Il lutte avec Dieu), car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu as vaincu.".
Jacob (dont on se souviendra que c'est l'époux de Rachel), pour avoir lutté avec Dieu, va donner naissance aux douze tribus d'Israël. Sa blessure à la hanche est féconde, opposée de celle du Roi Pêcheur.
Si on suit cette piste allégorique, la jambe d'ivoire frappant Achab à l'aine est l'ange, le cachalot blanc devenant un Dieu qui l'adoube par cette blessure inguinale mystique. Tout chasseur primitif ne combat sa proie que par défi de se dépasser soi-même et par volonté de recevoir par sa victoire ou par son seul combat l'hommage de son adversaire ; tout guerrier voit en les blessures reçues des marques d'affiliation.
On peut, c'est le propre des grands romans, développer les considérations à l'infini ; on peut trouver d'autres blessures à l'aine dans la littérature. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en écrivant ce chapitre, ce sont vers ces vastes espaces de réflexion que Melville a souhaité nous engager.
Pourtant, je distingue, dans ce chapitre 106, dans ce roi méhaigné mais repartant au combat, un trou.
Oui, un trou, une forme en creux, une absence.
Je cherche.
Je trouve : la pièce du puzzle qui s'insère parfaitement, prouvant que le dessin du texte, sa texture, ne doit rien au hasard, c'est la phrase du chapitre 119 : Achab, en plein orage, a saisi la chaîne qui descend du mât et sert de paratonnerre. Achab le consummé, le cuit, le foudroyé tient tête aux puissances célestes et s'écrit "À présent, je te connais, clair esprit, et je sais que pour bien t'adorer il faut te défier.[...] Je reconnais ta puissance, qui est sans voix et sans lieu, mais refuserai la domination inconditionnelle et absolue qu'elle exerce en moi. Au milieu de l'impersonnel par toi personnifié se tient une personne.[...] Ô clair esprit, de ton feu je suis le fils, et ce vrai fils du feu souffle en retour sur toi sa flamme."
Achab n'est pas de ceux qui adorent leur Dieu à genoux, mains jointes et les yeux baissés : "pour bien t'adorer il faut te défier", pour être digne de sa douloureuse filiation, du sceau fuligineux qu'il a reçu en venant à ce monde il doit affronter ce Dieu et refuser sa domination. C'est le geste fou du mortel face à l'immortel, c'est la prétention folle de l'imparfait face au grand Tout, son panache et son pied-de-nez. Aller jusqu'au bout de sa finitude, aller opiniatrement honorer en soi, non les qualités, non les aspirations au bonheur ou à la tranquillité, mais la faille, la blessure transmise de père en fils, la suppliciante nature humaine et la jeter en défi, front contre front, machoire contre machoire, à la face de son Dieu.
On peut lire sur la toile :
http://ahistoryofnewyork.com/2012/12/moby-dick-big-read-day-88/
http://transatlantica.revues.org/5009 : Sous l’empire de la folie : Moby-Dick, Shakespeare & compagnie , Michel Imbert



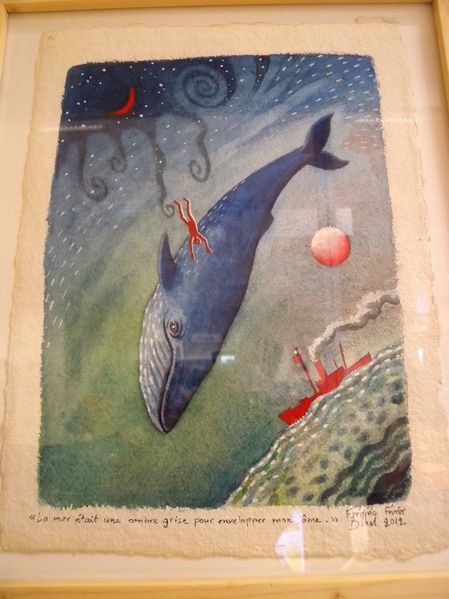



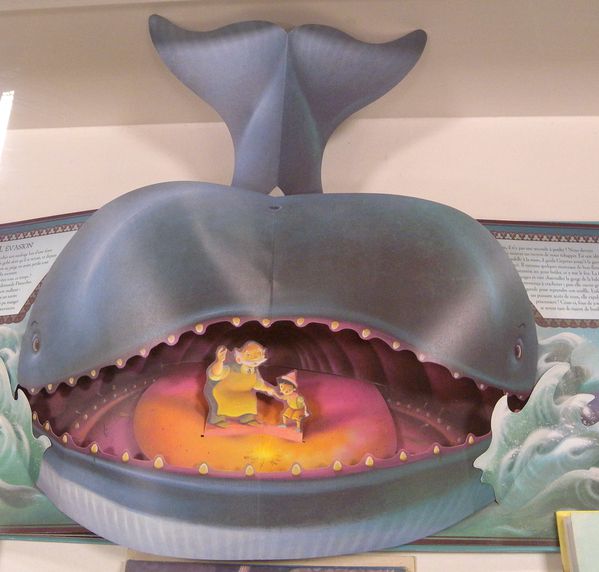


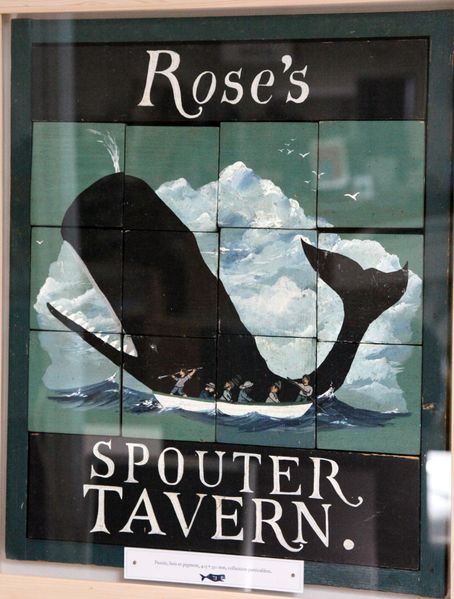

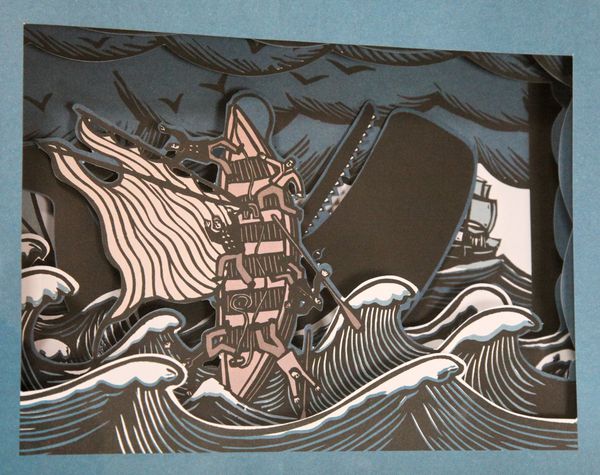
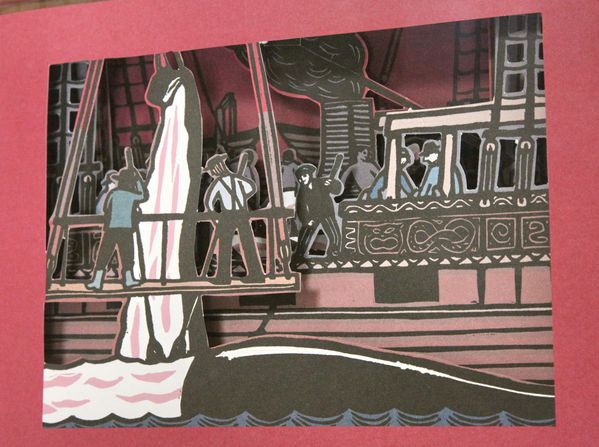
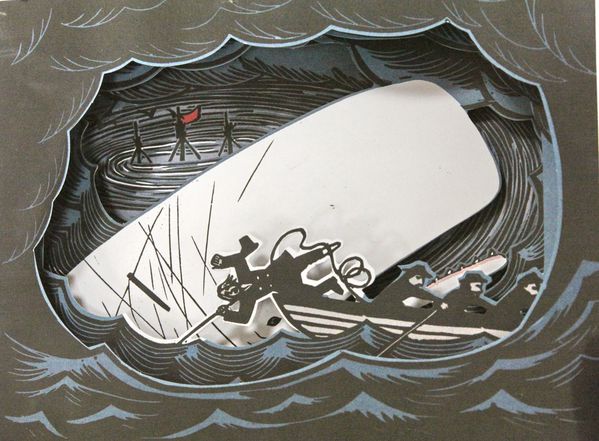
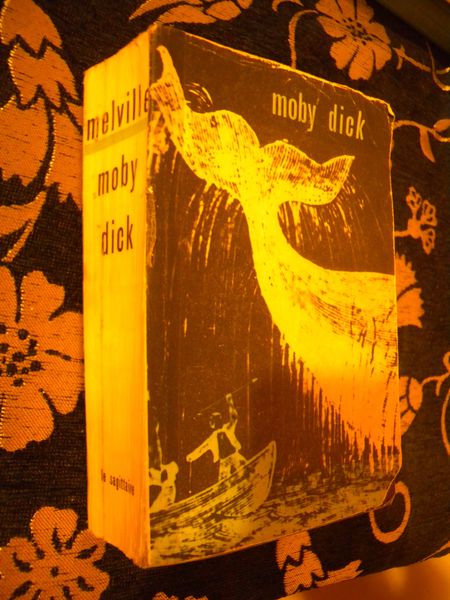


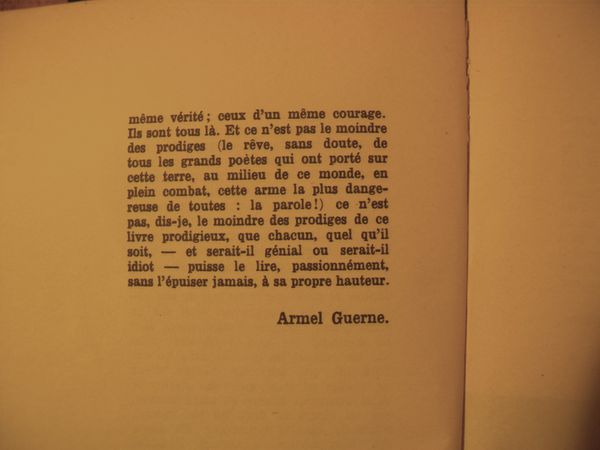
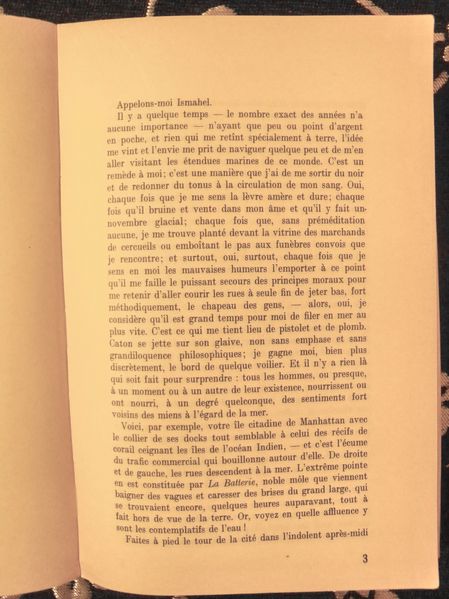
/idata%2F3438827%2Fex-libris---florilege-de-livres%2Fexposition-cachalot%2Fexposition-cachalot-0878c.jpg)








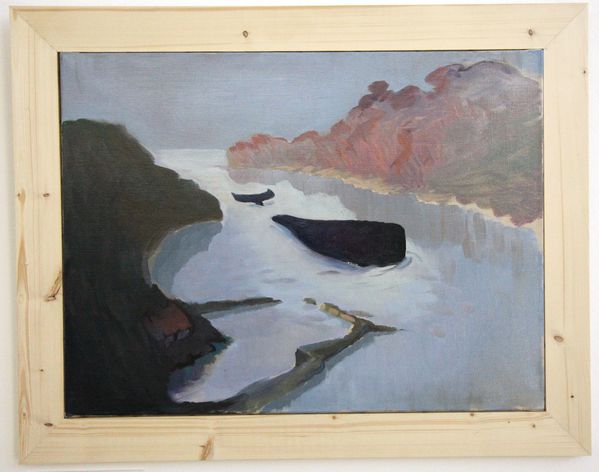


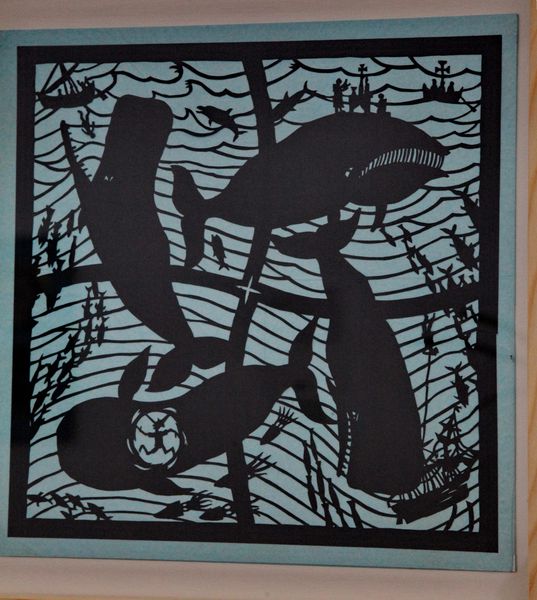
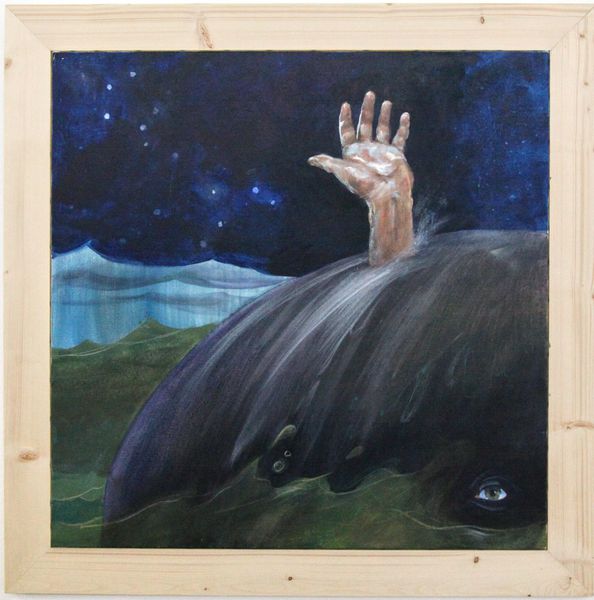
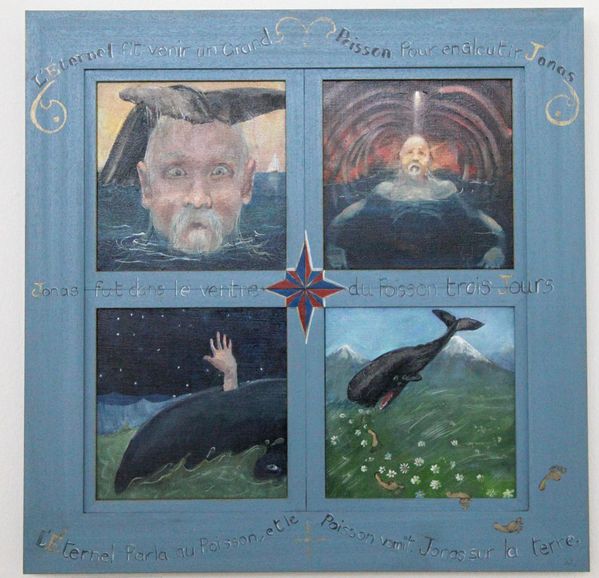









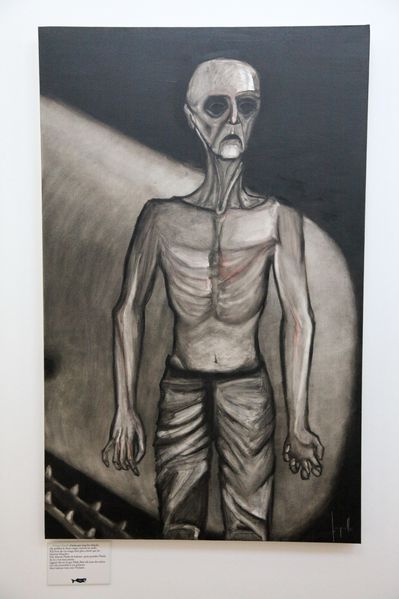

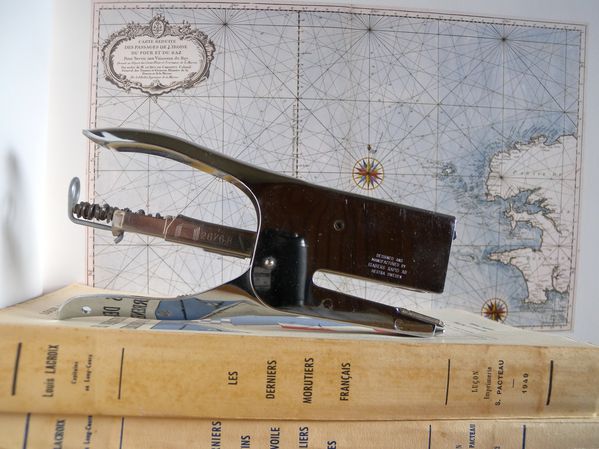

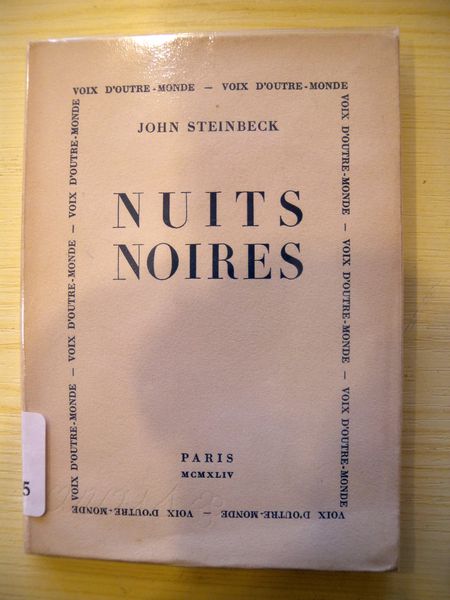

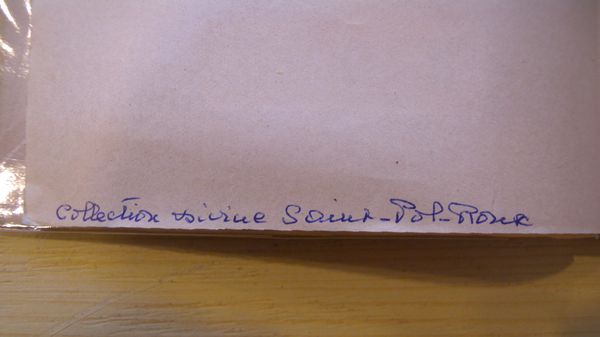



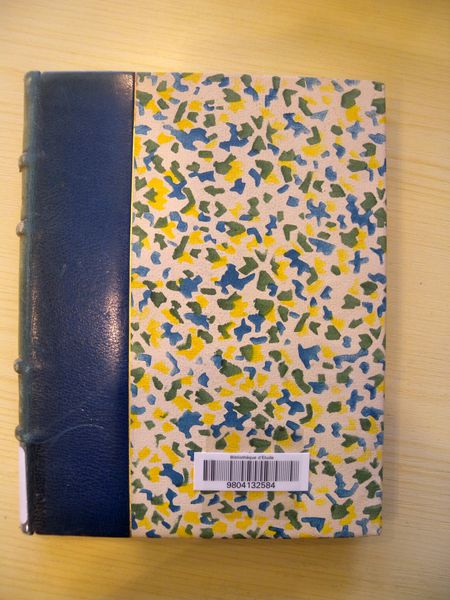
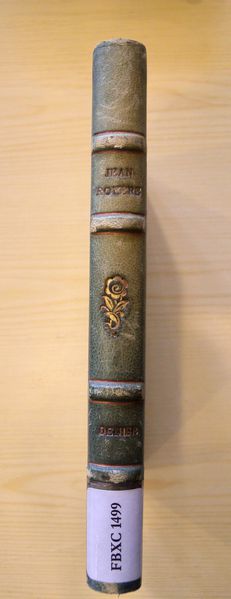
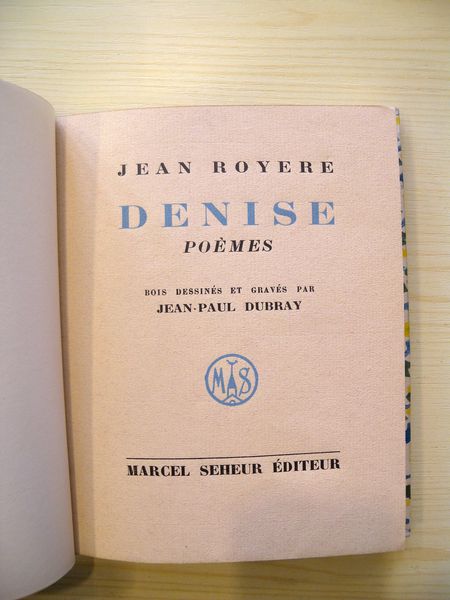


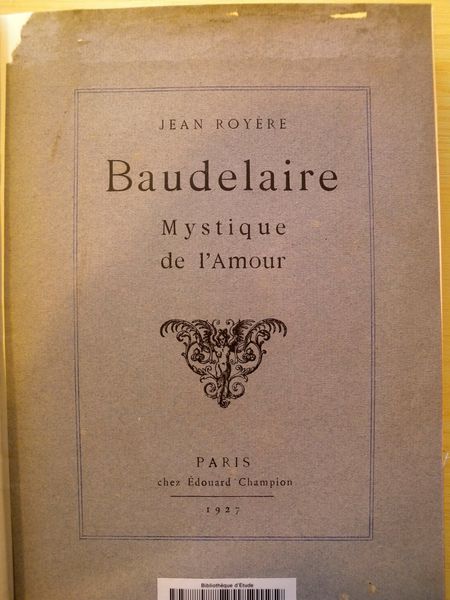
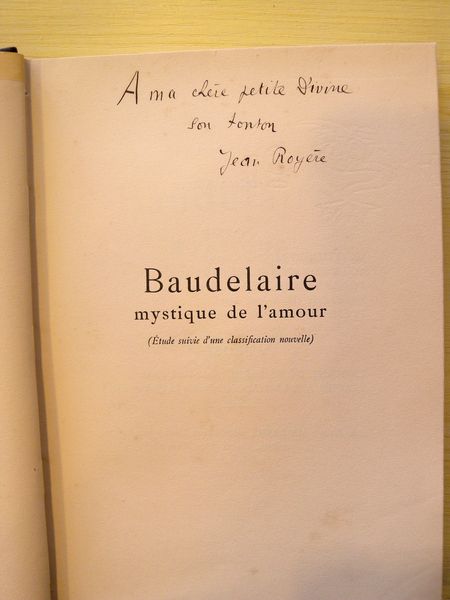

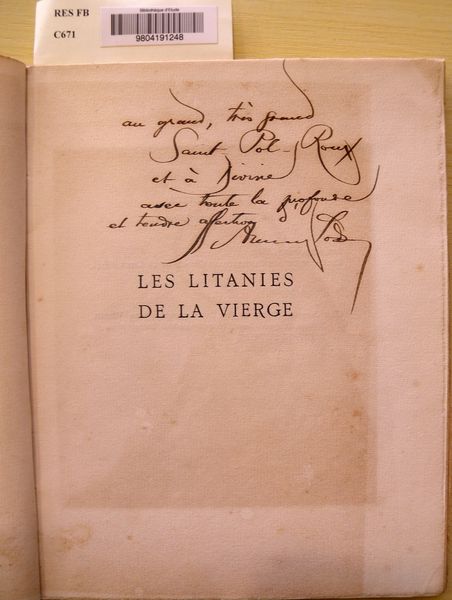
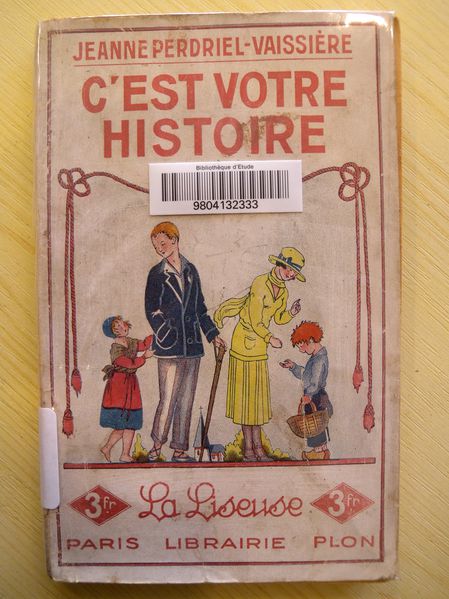














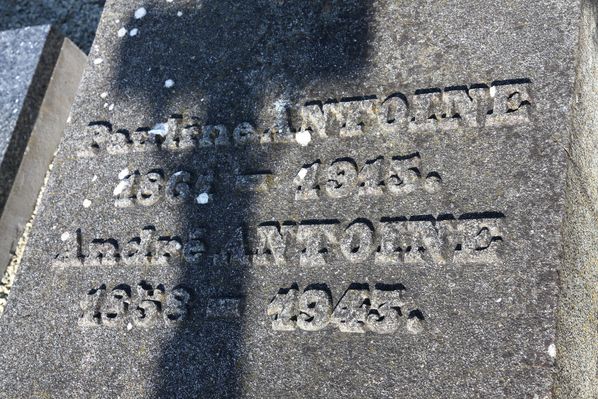
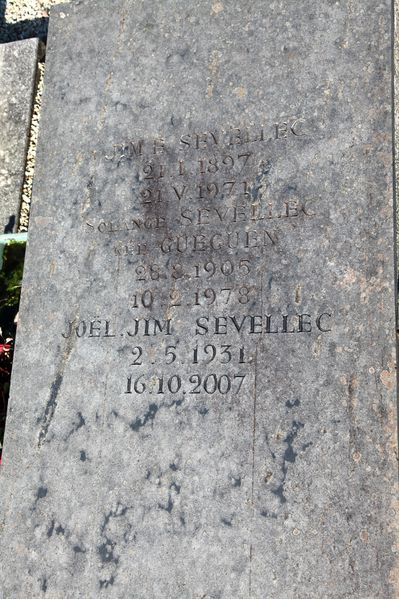
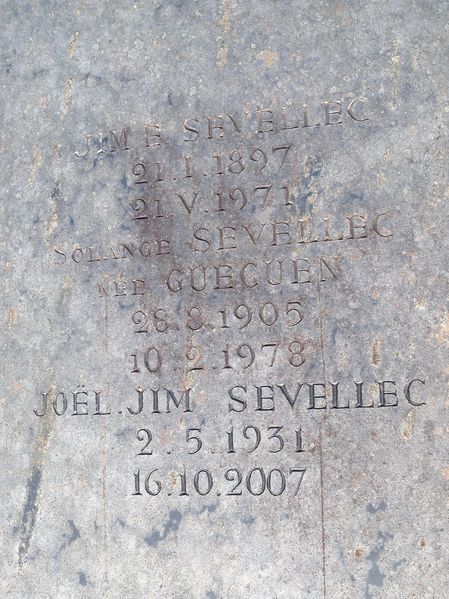






/http%3A%2F%2Fwww.culture.gouv.fr%2FWave%2Fimage%2Fjoconde%2F0440%2Fm071204_0002193_v.jpg) Le port de Camaret, M. Sauvaige, coll. Dieppe, Château-Musée.
Le port de Camaret, M. Sauvaige, coll. Dieppe, Château-Musée.





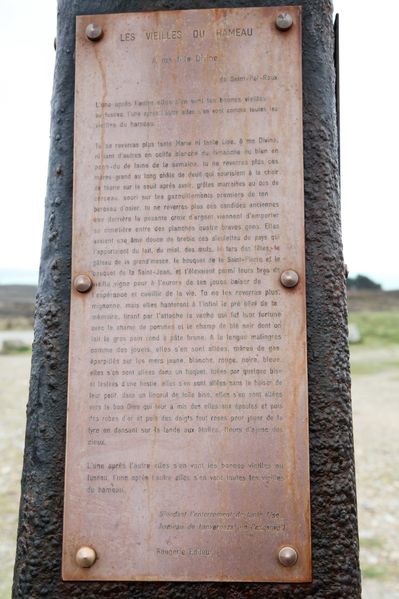



/http%3A%2F%2Fwww.cin-et-toiles.com%2Fimages%2Fbossu13.jpg)
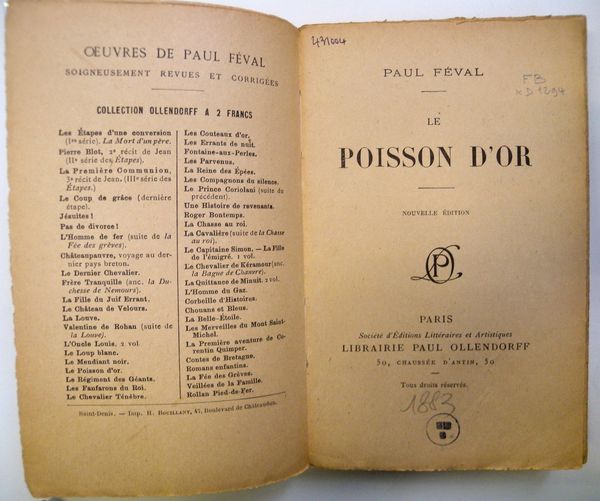
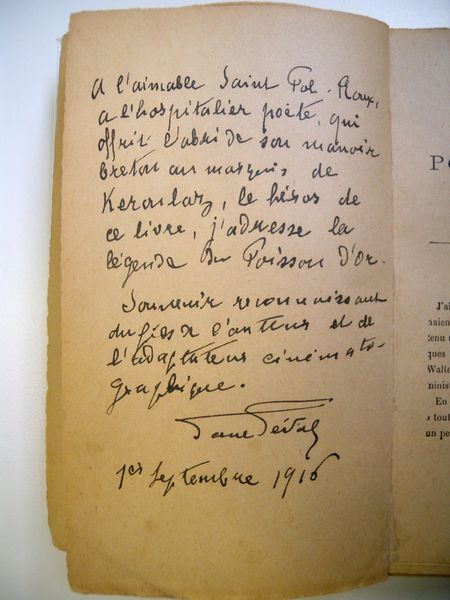
/http%3A%2F%2Fwww.agencebretagnepresse.com%2Fphotos%2F22726%2F2.jpg)

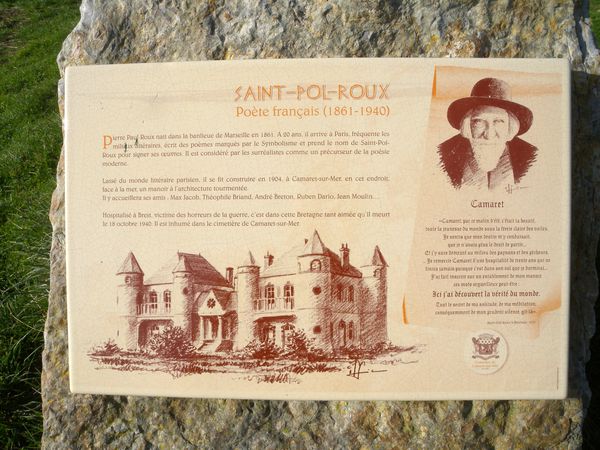



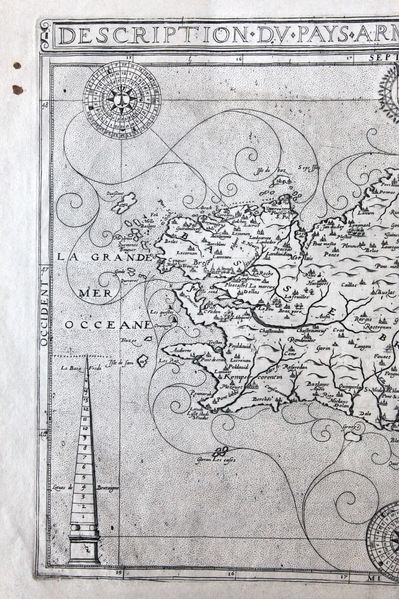
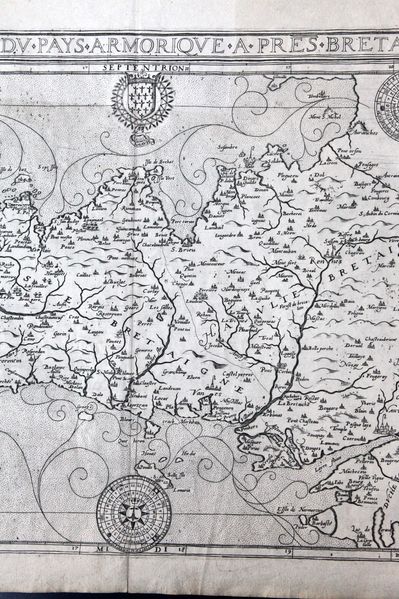


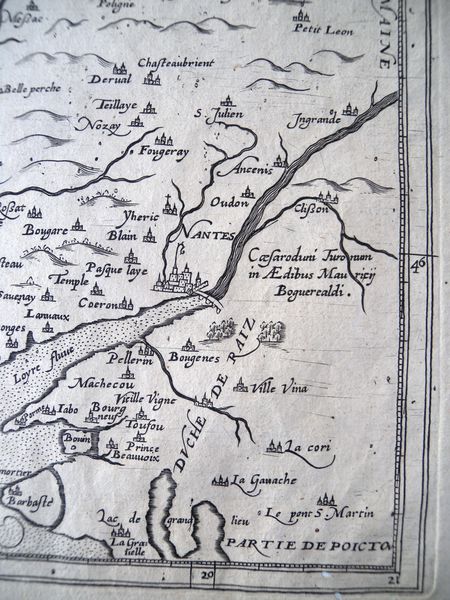

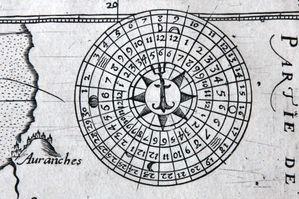
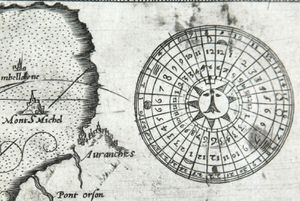

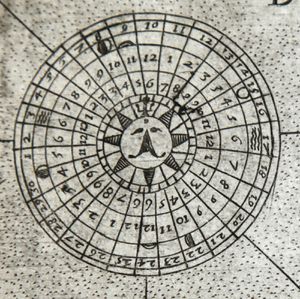
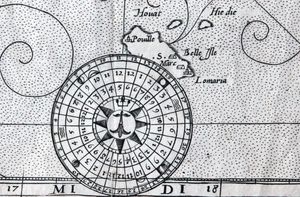
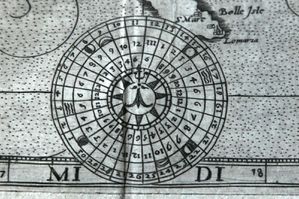
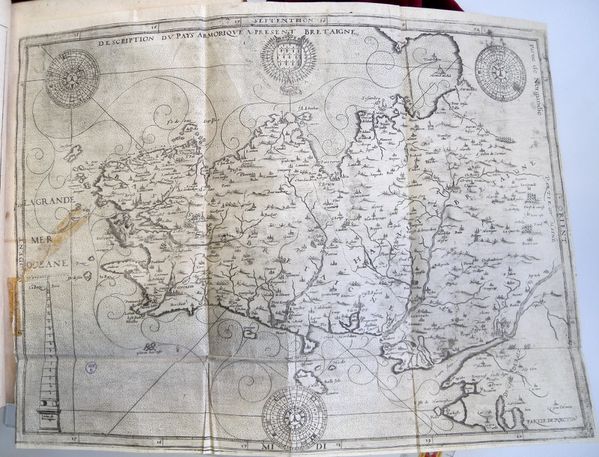
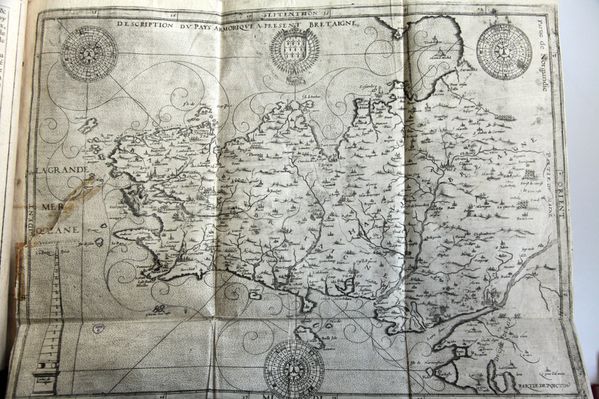

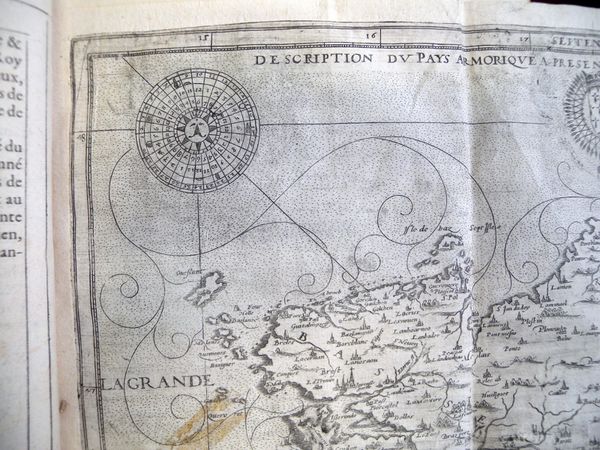






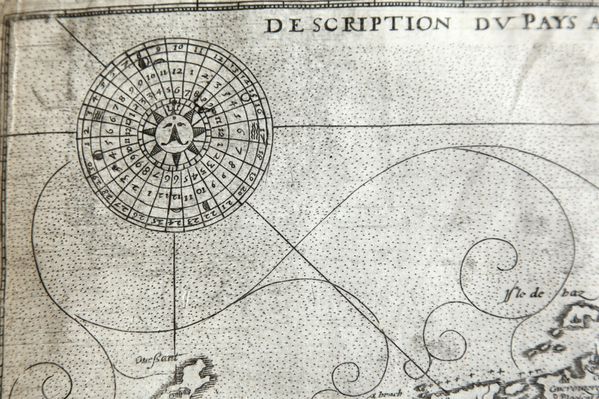
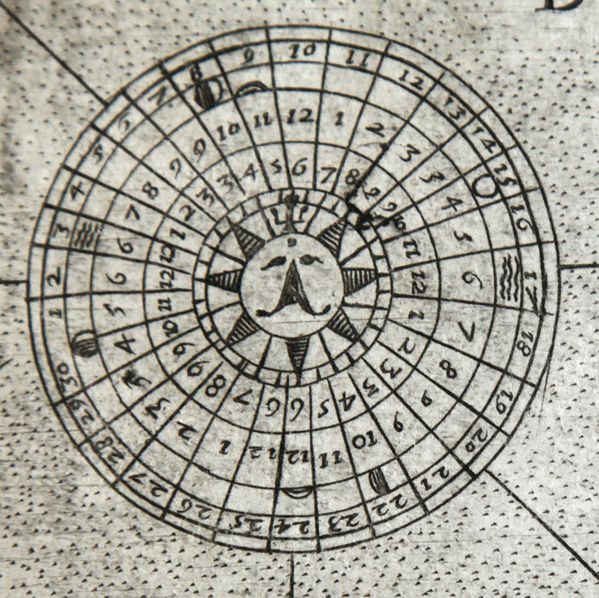
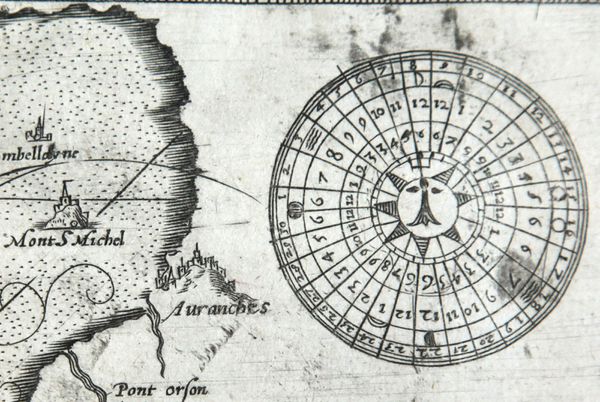




/http%3A%2F%2Fgallica.bnf.fr%2Fproxy%3Fmethod%3DR%26ark%3Dbtv1b55002488s.f49%26l%3D3%26r%3D64,0,524,420)



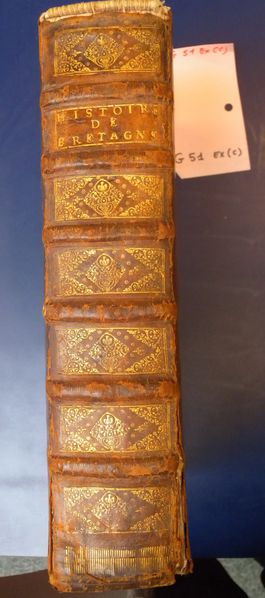


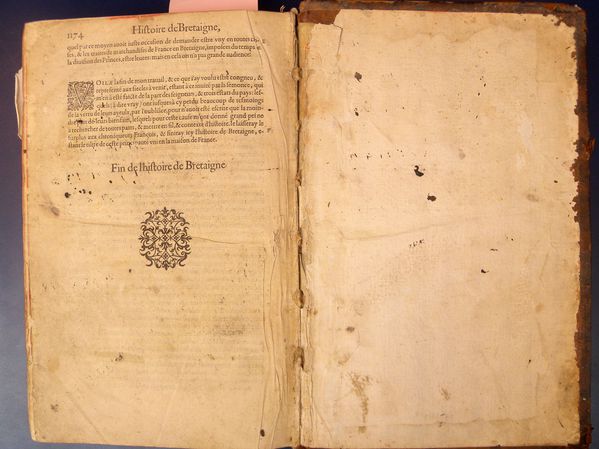



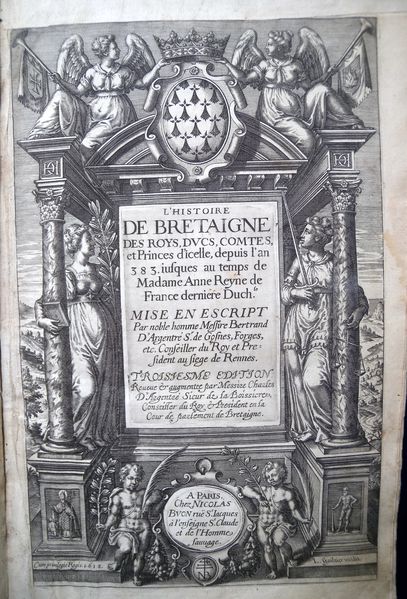


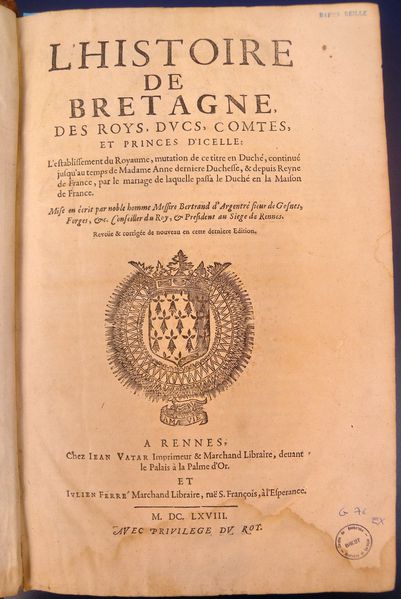
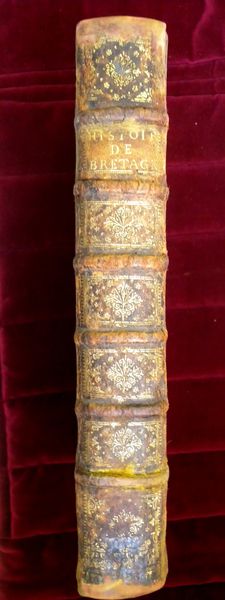

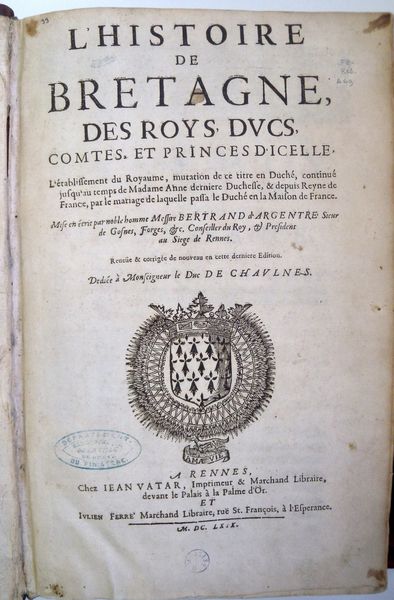
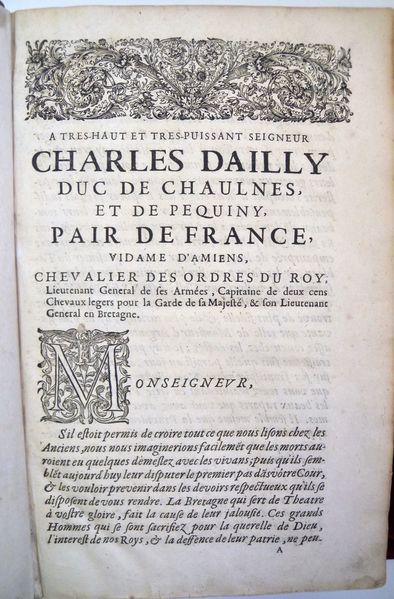
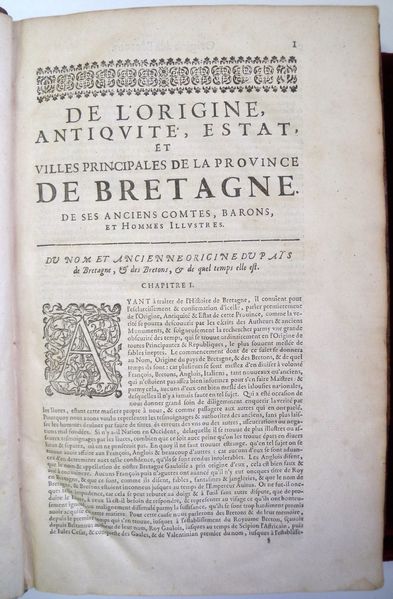
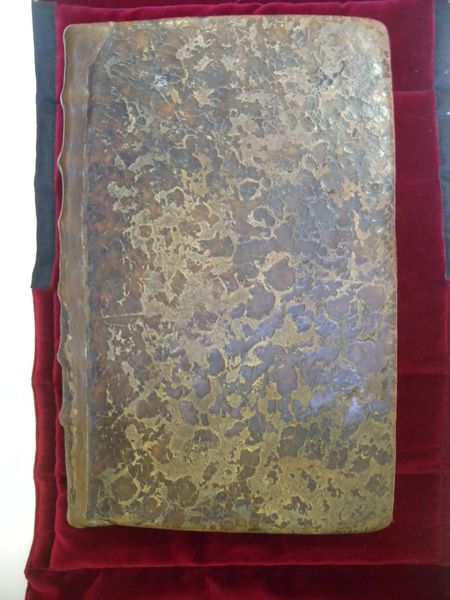


/image%2F1401956%2Fob_10ee47_dlupgb2v-normal.jpeg)